Devant la vision de l’araignée, mon émotion n’est pas venue d’apprendre que c’était une tarentule, même si cela a enrichi ma compréhension, mais de ne pas savoir ce que c’était que cette chose. Tenir à la vision esthétique, résister à l’identification scientifique, c’est rendre hommage à l’émotion qu’on a ressentie, au vertige devant l’inconnu. L’inconnu n’est pas une forme vide qu’il faudrait remplir de connaissances, mais une promesse d’images. À l’instant où je ne sais pas ce que je vois, je vois plus car mon esprit essaie d’accommoder, il forme une image.
Les scientifiques et les philosophes du vivant, qui leur emboîtent le pas, s’empresseront de réduire une telle analyse à une projection sentimentale ou à une représentation symbolique. Or c’est méconnaître que, dans le rapport à l’image, l’imagination et la mémoire sont déjà impliquées. Le regard scientifique peut aider mais il est un parmi d’autres, il ne prévaut pas. Il propose de quitter les rives de l’interprétation pour connaître les modes de vie, les territoires, les organes et leurs fonctions, toutes choses qui peuvent être belles et utiles à savoir, mais on aura beau faire, je verrai toujours une barbe à la place des crochets de l’araignée, ou en même temps que les crochets : on ne convertira pas mon regard.
Sinon cela signifierait revenir à l’âge d’avant l’esthétique, celui de la représentation, où on s’arrêtait à l’assignation des choses. L’animal est toujours si étrange qu’il m’apparaît au contraire comme un mystère inépuisable, une fiction.
Les travaux actuels sur le vivant apportent du savoir pour voir le monde et les œuvres, mais ce savoir n’apprend pas forcément à voir, pour reprendre un titre récent (Apprendre à voir d’Estelle Zhong Mengual, 2021). Godard dirait même : ce savoir empêche de voir. L’image est en froid avec le concept, on le sait. L’image ne naît que de l’adieu au langage, les mots empêchant de voir les choses. L’image suppose une capacité à faire confiance à sa perception jusqu’au délire. L’image est un mixte absolument indémêlable de perception et d’imagination. Elle n’est pas le résultat idéel d’une classification et d’un nom.
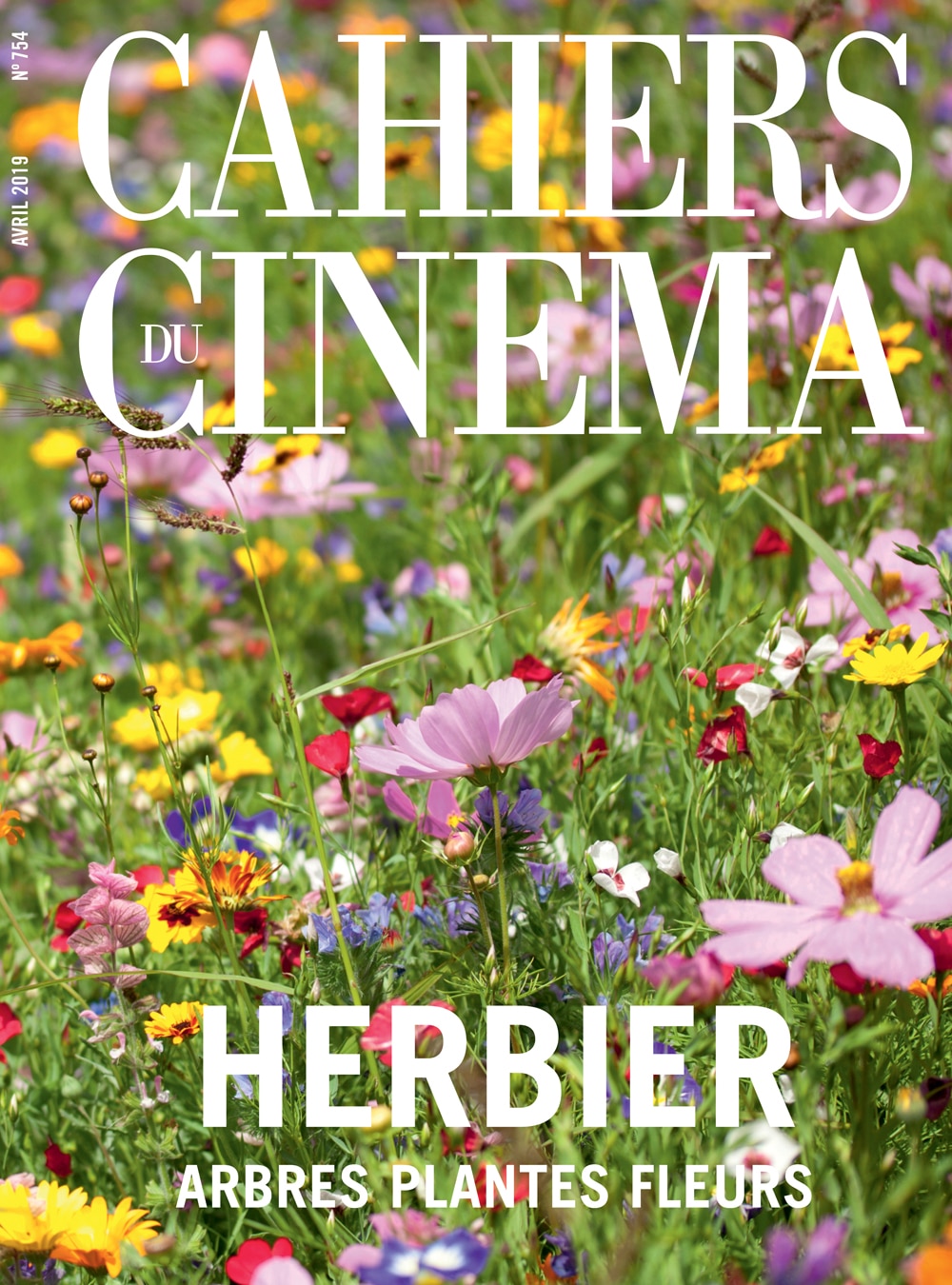
Pour être juste, il faudrait pouvoir rendre hommage aux deux regards. Le premier de qui ne sait pas, et le second de qui sait. Il y a quelques années nous avions conçu, aux Cahiers, un numéro « Herbier » (avril 2019) pour donner toute leur place aux plantes dans les films. Le mouvement était double. D’une part regretter que les cinéphiles (et nous-mêmes) soient si incultes sur le nom des pantes et des fleurs et donc les nommer en adoptant la forme scientifique de l’herbier. Il fallait bousculer la paresse descriptive et comprendre que les cinéastes que nous citions savent ce qu’ils filment. Ce premier geste prenait donc à revers la pensée godardienne : il faut nommer pour voir. Car plus on sait, plus on voit. Mais il s’accompagnait d’un deuxième geste, dialectique : il faut oublier qu’on sait. Ce qui suppose déjà de ne pas faire comme si on savait, selon cette manie des experts qui font croire qu’ils savent déjà et qui ne s’étonnent jamais de rien. Qui calfeutrent les fenêtres par lesquelles un peu d’ignorance pourrait passer. Mais plus largement, il faut oublier qu’on sait, pour faire confiance à ce qu’on voit, pour que le nom ne fasse pas écran à la chose.
Qu’est-ce que c’est que cette chose ? est le graal de l’esthétique, et il est probable que les scientifiques ne comprendront jamais pourquoi cela nous excite autant, pourquoi nous sommes à la recherche du grand frisson de ne pas reconnaître, de ne plus comprendre. C’est que ce frisson métaphysique est le moteur des images : ce n’est pas un absolu ineffable, au contraire il fait écrire et parler. De ce trou sortent des images multiples, primitives, psychiques, qui ne concernent pas que nous, dans notre soi-disant narcissisme moderne, mais qui mettent en jeu en profondeur notre rapport à l’animal.
Il y a là une distinction importante à faire entre rapport et relation. Baptiste Morizot prétend mettre en avant une philosophie de la relation à l’animal et plus largement au vivant. Mais le vivant n’en a que faire d’être en relation avec nous. Il faut d’abord et avant tout respecter cette distance et cette indifférence. Dans la relation, on échange, on commerce, on pactise, pour « vivre ensemble », avec un postulat de réciprocité. Dans des exemples ponctuels de cohabitation (primates, loups), cette prétention est compréhensible, même si déjà discutable, mais qu’en reste-t-il pour les insectes, les oiseaux, les poissons, les plantes ? L’horizon de Morizot est le bon « vivre ensemble », avec des « égards ajustés pour le vivant » (dans la conclusion de son livre Manières d’être vivant, 2020). Or l’animal exige beaucoup plus que cette domestication du regard. Il exige notre stupeur, il doit rester à distance.
Une mise en rapport est différente d’une mise en relation. Mettre en rapport, c’est comparer, différencier tout en gardant la distance, alors que mettre en relation, c’est mettre en contact. Mettre en rapport suppose qu’on cherche des différentiels, mettre en relation suppose qu’on cherche des homogènes. Le rapport appartient à l’âge esthétique, la relation à l’âge de l’information et de la communication (« on entre en relation »).
Face au visage de l’araignée, mes armes ne sont ni scientifiques ni communicationnelles mais esthétiques : je suis dérangé par cette inquiétante étrangeté ou par ce mécanique plaqué sur du vivant, ou par son aura, pour employer trois notions esthétiques clefs qui essaient de formuler différents rapports. Dans l’aura, Benjamin désigne un rapport entre le proche et le lointain ; dans le Rire, Bergson désigne un rapport entre du mécanique et du vivant ; un même rapport que Freud interprète tout différemment avec l’inquiétante étrangeté. Toute l’esthétique est fondée sur des rapports et des montages dialectiques. Le rapport de temps (entre deux espèces), de proportions, de mouvement, de territoire, entre l’animal et nous, mais aussi les rapports de mouvements, de vitesse, de couleurs, de l’animal lui-même, ses rapport à son environnement, tout cela attaque directement notre esprit, nous ébranle de manière métaphysique.
Ce n’est pas simplement un modèle esthétique de contemplation d’une image qui s’opposerait à un modèle de rencontre effective sur le terrain avec l’animal. Ce rapport esthétique-anthropologique est le même dans la nature. Morizot, qui piste les animaux sauvages, dit que lorsqu’il voit un loup, ils se regardent d’une certaine manière « d’homme à homme » dans une mise en contact sur un pied d’égalité. Cette affirmation laisse perplexe. On peut penser à l’inverse qu’il n’y a pas de relation, mais seulement un rapport complexe, mystérieux, indécidable, sans réciprocité, deux regards qui ne peuvent se rencontrer. D’ailleurs lorsque le contact n’a pas lieu comme prévu, le pisteur est déçu. Et le philosophe d’avouer que la vraie aventure est le pistage lui-même, pas la rencontre avec l’animal, trop hasardeuse. « L’émotion si intense du pistage, plus forte en un sens que de voir l’animal de ses yeux, revient à ce qu’on voit par ses yeux. » (Les Diplomates, 2016) Dans cette étrange prétention, la traque se transforme en un jeu de rôles où l’homme joue à l’animal. La relation empêche donc de voir l’autre. On se dit alors qu’un promeneur est peut-être plus à même d’avoir un rapport anthropologique à un animal qu’un pisteur. Tomber par hasard sur un renard dans la forêt, qui vous suit, apparaît et réapparaît, sans que vous sachiez s’il vous surveille ou joue avec vous, être pris sous le regard de l’animal qui vous regarde dans votre dos : voilà une expérience extraordinaire de dépossession de soi et de son espèce.
Le spectateur de cinéma est ce promeneur, il n’est pas un scientifique ou un chasseur qui piste les signes. C’est un grand distrait. Ou bien il est plus proche de l’analyste en situation d’écoute flottante. Il n’identifie pas tout, il se peut même qu’il ait une certaine forme de bêtise dans sa perception égale des images. Il fait penser à l’homme ordinaire dans son rapport à la nature. Morizot se moque de ceux qui viennent chercher le calme dans la nature alors que le vivant bruisse de combats, de séductions et de crimes en plein air. On comprend que le philosophe du vivant veuille ouvrir les yeux et les oreilles de celui qui a une perception tronquée. Mais en retour que lui donne-t-il à percevoir ? Uniquement des actions qui relèvent du domaine du conflit, de la diplomatie, du commerce social, de la séduction, de la stratégie de territoire. Il décrit un monde en conflit perpétuel. Précisément un monde qui ne se repose jamais. Précisément un monde inverse à celui qui dans sa rêverie vient se reposer là et laisse flotter son esprit. Dans un effet de miroir troublant, on retrouve exactement l’idéologie que les manuels de scénario enseignent aujourd’hui : que tout récit est avant tout conflit. Que chacun se bat pour un territoire, une conquête, noue des alliances, tente de séduire, se débarrasse de ses concurrents ou fait preuve de diplomatie, etc. On ne sort pas de cette tyrannie sociale. Pourquoi la plaquer sur notre rapport aux animaux ? (Et sur les rapports des animaux entre eux ?). Le rêveur n’entendra pas tout ce bruit, mais se mettra peut-être en rapport avec le sifflement d’un oiseau inconnu, et si il est un peu mélomane, il écoutera le chant autrement que comme une parade ou une mise en garde, et d’autres prodiges lui apparaîtront.
Faut-il se mettre en relation avec les animaux pour identifier leurs relations ? On peut au contraire explorer les rapports. Ce sont deux démarches différentes. Comprendre telle stratégie de séduction ou d’invasion ou de résistance peut être merveilleux pour enrichir notre vision du vivant, mais cela ne peut se faire au détriment de ce noyau dur d’étrangeté de notre rapport à l’animal. Même si tout savoir est bon à prendre, il faut pouvoir laisser la place au doute et au mystère qui nous sépare.
Stéphane Delorme

