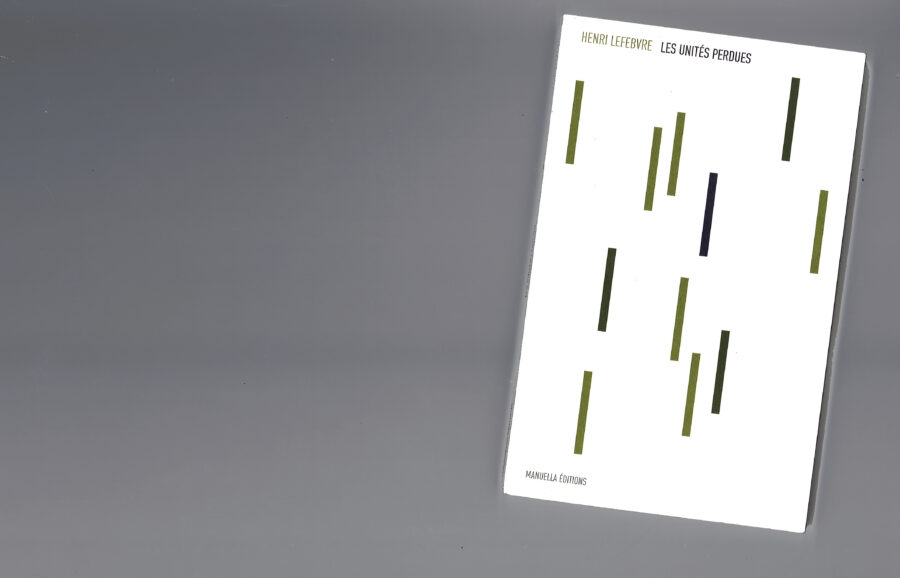Damien Guggenheim : On peut dire que votre livre, Les Unités perdues, est un recueil : il rassemble sous forme de liste, avec ce que celle-ci peut parfois comporter d’impitoyable, un inventaire d’œuvres disparues. Cet inventaire ne saurait bien sûr être exhaustif. Y-a-t-il, en revanche, une première rencontre avec une œuvre perdue, à l’origine de ce projet, un élément déclencheur ?
Henri Lefebvre : Pour être tout à fait précis, plusieurs circonstances ont favorisé l’émergence du projet qui s’est fait en trois temps. Dans un premier temps, il faut savoir que je porte depuis l’adolescence un très grand intérêt aux biographies d’artistes. Artistes au sens large : peintres, compositeurs, écrivains, cinéastes, etc… Très rapidement, à la lecture de ces biographies, j’ai été confronté au thème récurrent de la perte d’œuvre. La perte est commune, tous les artistes perdent des œuvres. Ce sont, la plupart du temps des pertes involontaires, mais elles peuvent être aussi volontaires. Je me suis rendu compte, en particulier pour les pertes involontaires, que je ressentais très douloureusement une perte de cet ordre, essentiellement parce que j’imaginais alors l’impossibilité de refaire à l’identique le manuscrit perdu, la toile détruite. Je me suis mis à la place de celui qui perd. Quand ce qui est perdu l’est irrémédiablement, c’est insupportable. C’est ce ressenti douloureux qui est véritablement le premier « élément déclencheur » du projet.
En outre, je ne savais pas comment répondre à l’embarras que me provoquaient ces pertes. Et puis un jour je me suis mis à noter une perte lue. Cette toute première perte notée, relevée dans l’autobiographie d’Elias Canetti, « Histoire d’une vie », concerne le sculpteur autrichien Fritz Wotruba qui, avant de quitter Vienne en 1938 pour la Suisse, avait décidé d’enterrer une sculpture intransportable dans un lieu public de la capitale autrichienne. À son retour à Vienne, en 1945, il cherche à la récupérer mais la sculpture reste introuvable, elle avait totalement disparu. L’écriture de cette première anecdote est le deuxième élément déclencheur du projet. Je vais, par la suite, noter systématiquement toutes les pertes d’œuvres relevées dans les biographies d’artistes que je lis.
Troisième temps : quand cinq pages ont été écrites, je les soumets à mon amie, poétesse déjà « consacrée », qui trouve ce texte captivant. Je suggère d’envoyer ces cinq pages à la revue IF (à Marseille), ce qu’elle m’encourage à faire. Un mois plus tard, je reçois un coup de fil de Jean-Jacques Viton qui se dit heureux de publier ce texte dans la prochaine livraison de la revue, en avril 2001. Le lendemain, Liliane Giraudon me téléphone à son tour pour me proposer de faire des « Unités perdues » le feuilleton de la revue IF, tout le temps qu’il me plaira de m’y consacrer. J’accepte et commence un « travail » très consciencieux de collecte de pertes d’œuvres. Une semaine après la première publication, je reçois une lettre de François Dominique, des éditions Ulysse fin de siècle. Il lance l’idée d’un livre, ce à quoi je n’avais pas pensé ; j’avais entamé la rédaction d’un livre sans le savoir1.
DG : Ce travail repose nécessairement sur des témoignages de première ou de seconde main. On oscille ainsi constamment entre le constat de police et la légende plus ou moins apocryphe qui entoure les faits et gestes des artistes. Or comme souvent dans l’art conceptuel, la légende suffit à la transmission d’une œuvre. N’est-ce pas là sa force que de pouvoir survivre, malgré sa disparition, par sa renommée ?
HL : L’ambiguïté qui entoure mon travail me réjouit ; j’aime à croire que je peux être à la fois dans l’écriture et à la fois dans une proposition conceptuelle qui trouverait sa place dans le monde de l’art contemporain. La référence que vous faites à l’art conceptuel est de ce point de vue tout à fait pertinente. L’œuvre existe par ce que l’on en dit, que ce récit devienne légende ou non. Son existence se doit au verbal ou au texte, à ce qui entoure l’œuvre physique, matérielle. Une œuvre survit à sa perte parce qu’on la nomme. Renommer ce qui a été détruit pour que cette nomination fasse œuvre, ou refasse œuvre, de sorte que l’œuvre perdue reprenne vie sans même avoir recouvrer son aspect matériel. C’est tout l’effort de ce livre, sa raison d’être. Redonner une place de sujet à l’œuvre perdue ; ce que je n’avais pas formulé au moment de la rédaction du livre que je me suis évertué à écrire sans me poser de questions. Pourquoi écrire sur ce qu’on sait déjà ? Je préférais découvrir à la « fin » du livre la raison de mon acharnement à le rédiger.
DG : Au-delà de ce qui ressort d’accidentel, il y a également la dimension historique. Beaucoup des œuvres que vous mentionnez font partie des dommages collatéraux de la guerre, quand celles-ci ne sont pas directement visées. Votre livre est par là un récit qui raconte l’envers de l’histoire, mais aussi la face sombre d’une histoire de l’art qui repose sur des œuvres connues et reconnues, et qui cherche à leur assurer une survie dans la postérité. La liste est-elle pour vous la forme littéraire pertinente pour rendre compte justement d’une histoire impossible à écrire ou d’une histoire qui ne fait pas récit ?
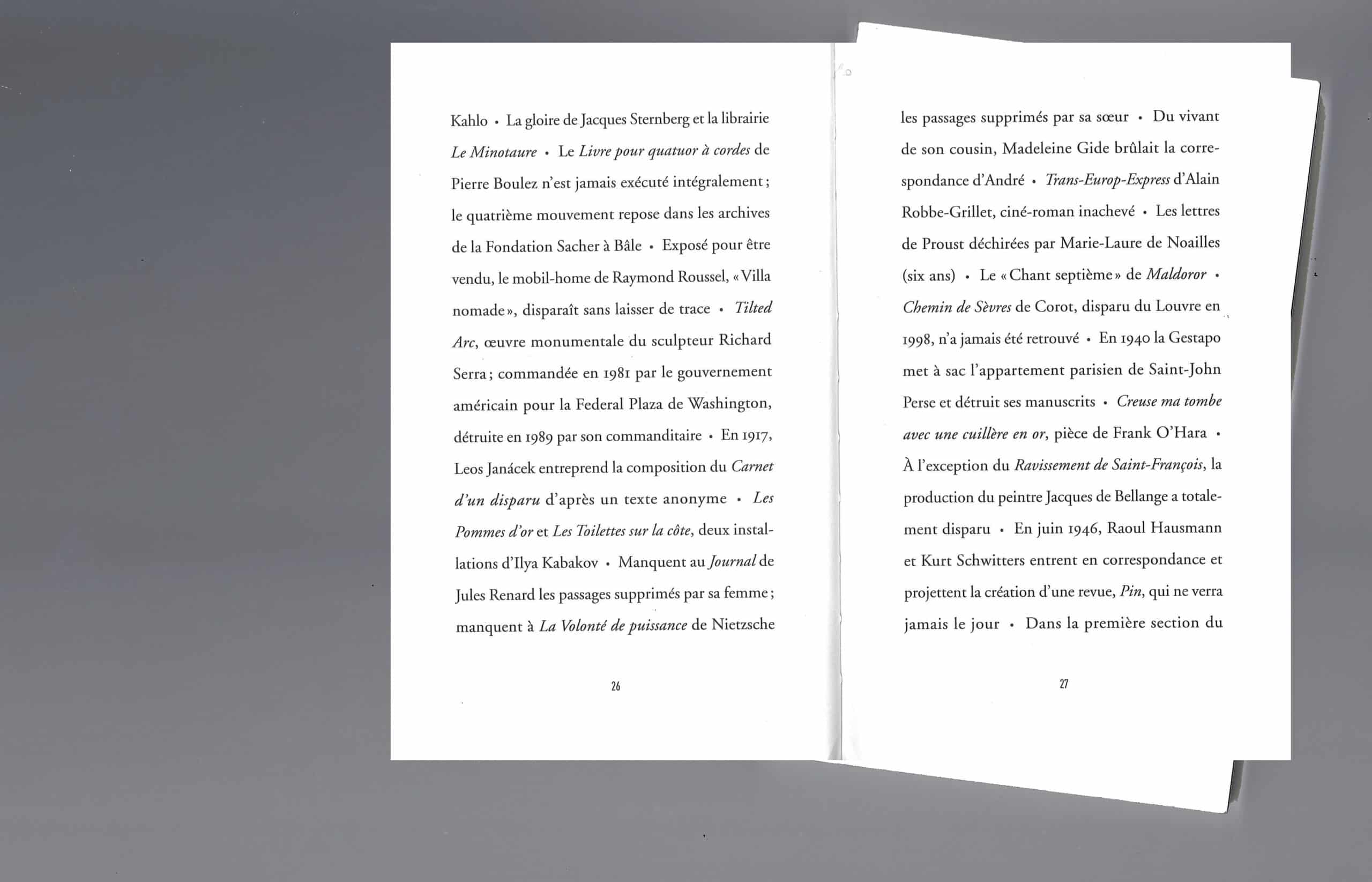
HL : La liste, cette litanie en particulier (Les Unités perdues), se pose sur une peine ; elle n’est pas heureuse, elle ne sait dire que le rappel de destructions dues, souvent, aux conflits humains, armés, mais pas uniquement. Les destructions, les pertes sont aussi parfois le fruit d’un hasard malheureux, d’une maladresse, d’une négligence. Elles peuvent être également décidées par l’artiste, qui regrettera ou ne regrettera pas son geste ; quand John Baldessari brûle, en juillet 1970, ses œuvres réalisées entre 1953 et 1966, il n’y a pas chez lui l’once d’un remords.
Ce n’est pas que la liste soit pertinente pour rendre compte d’une « histoire qui ne fait pas récit », elle fait « récit » autrement, sans recours à la narration développée, traditionnelle. La liste dit le principal (ici : la perte, le manque). La litanie n’est pas véritablement un discours, elle ne développe pas, elle souligne. La liste est bien habilitée à cet exercice du rappel (d’œuvres perdues) parce qu’elle est efficace sans être exhaustive – par « efficacité » entendre : énoncé bref et percutant – la liste multiplie les informations brèves –, et traitement sobre. L’émotion doit beaucoup à la sobriété de ce traitement. L’émotion née de cette logorrhée, de cette succession de secousses. Alors oui, je pense qu’elle est la forme idéale pour une narration qui ne peut se faire que dans le fragmenté.
La liste va au concis, au temps court. L’accumulation des pertes provoque à la fois le malaise – on est démuni devant tant de catastrophes –, et une certaine forme de plaisir – elle redonne vie (en partie) aux œuvres disparues en les citant ; elles sont rappelées deux fois : re-nommée, et re-distribuée dans le flux de l’histoire de l’art.
DG : La question lancinante qui traverse l’ensemble ouvert de cette collection, de ce musée fantôme, est celle du manque. Nous sommes, autrement dit, confrontés à notre désir d’art. Ces œuvres nous manquent-elles ? Que perd-t-on avec elles ? Peut-on dire que votre travail se fonde sur une démarche archéologique ? N’est-ce pas aussi l’idéal du chef-d’œuvre, avec ce qu’il peut comporter d’intimidation, de quête impossible, qui serait ici presque ironiquement attaqué ? Comme si l’abandon de ce paradigme était l’aboutissement d’un long travail de deuil ?
HL : Dans ce livre, dans tous mes autres livres, ce qui est attaqué – oui, il y a une attaque – c’est l’achevé, le fini. C’est certain. Ce qui se traduit d’abord par l’inachevé dans la forme : « Les Unités perdues » ne compte pas un seul point. Ce livre fait aussi l’économie du point final en lui substituant un blanc qui veut bien dire ce qu’il est : un infini dans lequel tout peut être instruit, placé. Chaque « unité perdue » est séparée de la précédente et de la suivante par un signe particulier, un petit rond noir en suspension au milieu de la ligne de texte. Par volonté, non pas de séparer ou d’isoler chaque unité l’une de l’autre, mais pour les enchaîner au contraire l’une à l’autre, toutes époques, tous sujets confondus. Pour dire l’universalité, l’intemporalité de la perte et du manque, pour dire aussi leur perpétuité. Rien ne s’achève, tout se transforme, tout se confond dans une prolongation discrète. Tout commencement est celui d’une fin qu’il prolonge.
Ensuite, l’inachevé dans le fond : ma volonté, depuis, est de n’écrire rien qui se termine. Je travaille mes textes en rappelant l’inachevé de tout (présent en tout). Si je comprends le « chef-d’œuvre », que vous évoquez, comme une œuvre magistrale aboutie, achevée, alors oui cette notion est ici attaquée continûment. Puisque rien de vivant n’est précisément abouti… Une œuvre supposée « finie » est à mon sens une œuvre éteinte autant qu’inutile. Le pausé, le statique, caractérisent des états à proscrire, malheureusement communs et quelquefois défendus. Or, une œuvre « achevée » est une œuvre manquée parce qu’elle est fixée dans un moment de son développement, parce qu’elle est amputée de son potentiel d’évolution. Ce sont deux douleurs : l’œuvre achevée et l’œuvre perdue. L’œuvre perdue c’est la vie effacée (« Les unités perdues » s’emploient à rappeler à la vie, à refuser l’effacement). Le pire c’est vraiment la vie effacée, ou bien encore la parcimonie, la prudence. On goûte à la vie un peu, à peine. Quand ce qu’il faut c’est ne pas la négliger. Ne pas la négliger c’est accorder de l’imprudence à l’imprévu. Et tout ira bien, ou peut-être mieux…
1 Suite au rachat des éditions Ulysse fin de siècle par Daniel Legrand, Les Unités perdues paraissent aux éditions Virgile en octobre 2004. Manuella Editions les rééditera en 2011. Le livre sera traduit en 2014 aux USA (Los Angeles), « The Missing Pieces », ed. Semiotext(e), traduction de David L. Sweet ; en 2018 en Suisse (Zürich) et en Allemagne (Berlin), « Die fehlenden Teile », ed. Diaphanes, traduction de Michael Heitz et Sabine Schulz ; et en 2019 au Portugal (Lisbonne), « As peças que faltam », ed. BCF, traduction de Ricardo Nicolau.