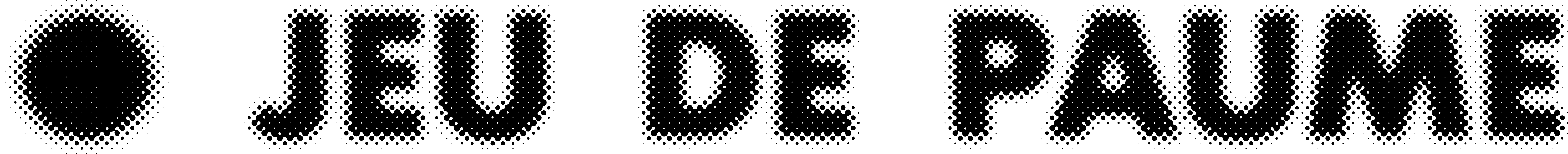Archive magazine (2009 – 2021)
Shelley Rice : Espaces changeants, frontières impossibles. Ana Mendieta et Liliana Porter.
Le chez-soi ‒ et sa nature insaisissable ‒ constitue un thème important dans l’art de Liliana Porter comme dans celui d’Ana Mendieta.
À l’instar des voyageurs de Porter, systématiquement positionnés à la fois à proximité et hors de portée, les voyages étaient pour Ana Mendieta un moyen de s’enraciner dans les interstices séparant les lieux, de déplacer les cibles affectives et de franchir des frontières impossibles.
« Mon art a commencé en disparaissant.
J’ai fait une offrande pour que la mer l’efface.
Les vagues tissent notre souffle, en dedans, au dehors.
La dissolution donne vie à ce qui succède. »
Cecilia Vicuña, Déclaration de l’artiste à l’occasion de l’exposition Disappeared Quipu, Brooklyn Museum, Brooklyn, New York, 18 mai – 25 novembre 2018))

Ce merveilleux texte de la plasticienne chilienne, extrait de sa « Déclaration de l’artiste », était affiché sur un mur jouxtant Disappeared Quipu, son sculptural et lumineux « poème dans l’espace », présenté au Brooklyn Museum au courant de l’été 2018. Décrivant à la fois littéralement et métaphoriquement les symboles proscrits des anciens Incas, son installation rendait hommage à d’autres modes de communication, aux artisanats et aux textiles, aux sons et aux images, qui donnèrent forme aux traces et aux récits de cette civilisation complexe n’ayant aucun lien avec l’écriture. Élément central de cette installation, les cordes à nœuds appelées quipu, bannies en 1583, ont « commencé en disparaissant », comme le dit Vicuña, leur absence « donnant vie » à la compréhension par l’artiste du patrimoine culturel latino-américain au sein duquel elle a vu le jour.

Pérou. Coton, fibres de camélidés, 33 x 94 cm.
Collection Brooklyn Museum ; Don de Dr. John H. Finney (Photo: Jonathan Dorado, Brooklyn Museum)
Née au Chili, Vicuña quitte son pays pour étudier à l’étranger, puis pour échapper à la dictature de Pinochet ; ayant vécu à Londres et Bogota, elle s’installe à New York en 1980. À l’instar de la Cubaine Ana Mendieta et de l’Argentine Liliana Porter, l’usage du monde de cette Latino-Américaine a lui aussi été façonné par le voyage, les déplacements, l’exil (par nécessité et par choix). Ces artistes ont toutes trois fait l’expérience de points de vue et de réalités différents, ayant pris le parti d’explorer ces interstices qui séparent les espaces fixes, les patries et les identités nationales. Avec Disappeared Quipu, Vicuña scrute les Incas à travers le temps et l’espace pour les comprendre. Elle redécouvre le langage des textiles anciens des Andes dans les collections du XXIe siècle du musée de Brooklyn, suggérant une histoire et superposant les géographies des deux Amériques. Le présent essai repose sur le postulat que cette méthode de travail, cette configuration perceptive et assurément cette vision interstitielle du monde occupent une place croissante dans l’art contemporain. Et qu’elles se révèlent plus particulièrement pertinentes, et descriptives, s’agissant de l’art de pionnières latino-américaines comme Vicuña, Mendieta et Porter.
« Je comprends maintenant que même si l’on vivait ici [à New York] mille ans, on peut n’y être jamais qu’un étranger. On m’a demandé récemment quand est-ce que je me suis finalement intégrée ici. J’ai répondu que ce qui est intéressant, quand on vit ici, c’est qu’on n’est pas obligé de s’intégrer. Les gens ont le droit de continuer à être différents, de vivre dans leurs propres pays, dans leurs pays personnels ; ici, on peut inventer son propre pays… » Liliana Porter((Liliana Porter, In Conversation, op. cit. p. 57. L’œuvre de Liliana Porter fait actuellement l’objet d’une rétrospective au Museo del Barrio, à Manhattan. L’exposition a ouvert ses portes le 13 septembre 2018 ; elle sera présentée jusqu’au 27 janvier 2019.))
Liliana et Ana étaient amies : de bonnes amies, de celles qui partagent dîners, connaissances et anecdotes personnelles, et s’envoient des cartes postales quand elles partent en voyage. Associée à un groupe actif d’artistes latino-américains composé notamment de Louis Camnitzer (son premier mari), Luis Felipe Noé et José Guillermo Castillo, Porter avait débarqué à New York en tant que touriste en route vers l’Europe et ses musées. Toutefois, séduite par la ville, elle décida de s’y installer. Mais avec une réserve : « La seule chose que je savais vouloir depuis toujours », expliquera-t-elle à Inés Katzenstein, « c’était conserver mes relations avec Buenos Aires, ne pas perdre mon identité d’Argentine, même si cette définition reste totalement abstraite, subjective et très difficile à expliquer((Ibid., p. 33.)). » Bien qu’elle réside dans l’État de New York depuis plus de cinquante ans, sa décision d’être différente, de demeurer délibérément étrangère, de créer dans son esprit, sa vie et son art, un « pays » qui lui soit « propre, personnel », a été déterminante.
Sur un certain plan, cette disjonction intentionnelle est l’élément central de sa pratique artistique. L’idée d’« inventer » son pays personnel va de pair avec la conception qu’elle se fait de ses œuvres, qu’elle considère principalement comme autant de propositions philosophiques, et secondairement seulement comme des déclarations matérielles, formelles. Dans son activité d’enseignante, ainsi qu’elle me l’a expliqué à l’occasion d’un entretien en août dernier((L’autrice a passé une journée chez Porter et dans son atelier de Rhinebeck en août 2018 ; toutes les références aux commentaires formulés lors d’un entretien avec Porter proviennent de la conversation qu’elle a eue lors cette visite.)), ce à quoi elle sensibilise ses étudiants en tout premier lieu, c’est qu’une œuvre d’art n’est pas le reflet d’une quelconque réalité, ni même liée à elle, et que c’est en cela que réside sa force. C’est un champ offrant à une nouvelle réalité la possibilité de prendre forme, où un lapin peut léviter, ou Che Guevara fréquenter (un morceau de fromage intitulé) Jeanne d’Arc, et de son point de vue, cette nouvelle vision doit passer avant la technique ou le médium. Sous cette perspective, un morceau de papier ou une toile ne sont pas des indices. Ce sont des mondes distincts, aux règles différentes, où tout est possible. Comme un pays inventé.

Dans ses œuvres, Porter laisse de vastes espaces vacants. Dessin, peinture, estampe, photographie, installation ou technique mixte, elles sont remarquables par le vide qui les occupe. Inés Katzenstein postule que cette vacuité de surface est fondamentale à l’expression de Porter, car elle lui donne la possibilité de se focaliser sur des « événements relationnels »((Inés Katzenstein, « Liliana Porter. Photography and Fiction », in Liliana Porter : Fotografía Y Ficción, cat. d’exp., Centro Cultural Recoleta, Buenos Aires, 2004, p. 197)). Le sujet ‒ faucille dessinée ou reproduction photographique d’un Jésus en plastique, figurines d’homme, d’ours ou de maison peinte ‒ est désamarré de son contexte, sorti de son habitat naturel. Repositionnés dans l’arène artistique de Porter, ces objets ou images (quelles que soient les divergences d’origine qui les distinguent, culturelles ou géographiques) semblent partager le même espace-temps, se rencontrer les uns les autres comme autant de « voyageurs virtuels… coexistant dans un nouveau continuum, dans un hyperespace où interagissent des temps et des espaces différents »((Gerardo Mosquera, « Liliana Porter : Shaking Hands with Mickey », in Liliana Porter Photographs (New York : Foundation for the Arts, 1996), s. p.)). L’espace vide, qu’il soit défini par le plan d’une toile ou d’une image photographique, un mur ou une console en bois, donne l’illusion de s’étendre dans la profondeur, de sorte que l’on puisse focaliser son attention sur des images ou objets disparates et parfois minuscules (souvent un bric-à-brac de bibelots produits en grandes séries, provenant de brocantes ou du commerce) de manière si intense que la différence entre représentation et réalité semble annihilée. Katzenstein fait remarquer que les photographies de Porter créent un « théâtre de répliques »((Inés Katzenstein, « Liliana Porter. Photography and Fiction », op. cit., p. 201)), où ces tchotchkes [« babioles » en anglais new-yorkais] issus de la culture populaire, déracinés, isolés et sans protection, semblent traverser l’espace, le temps, la culture et l’idéologie pour établir un contact ‒ les uns avec les autres et avec nous, leurs spectateurs.

Un tel déplacement temporel et spatial joue un rôle décisif dans la vision de Porter. Ses images parfois chargées sont souvent politiques dans leur banalité même. Dans le contexte de son travail, des figures de Jésus et du « Che » issues de la culture populaire prêtent leur poids idéologique à des icônes capitalistes comme Elvis et Minnie Mouse, effaçant les différences culturelles, philosophiques, économiques et sociales, tandis qu’elles « posent » ensemble ou semblent se donner l’accolade. Mickey dialogue avec le Lapin blanc d’Alice au pays des merveilles. Une figurine de soldat tire sur un cochon tirelire démesuré. Un tout petit homme posé sur une console de dimensions normales semble (très improbablement) en défoncer la surface à coups de pioche, tandis qu’une femme minuscule entreprend de balayer avec un balai lilliputien des monceaux de poussière rouge. Le titre de cette série, Forced Labor [« travail forcé »], nous met sur la voie de la profondeur et du sérieux de la pensée de Porter, du caractère implicitement politique de son art, tout divertissant et surprenant qu’il soit. L’échelle des objets est hors de proportion, comme sont déréglées leurs géographies, cultures, religions, idéologies, identités et interactions, tant sur le plan artistique que politique, car selon Porter, ses œuvres visualisent et suggèrent la possibilité d’une « rencontre avec l’Autre »((Liliana Porter, In Conversation, op. cit. p. 90)). Ses « protagonistes » – selon le mot de Gerardo Mosquera((Mosquera, op. cit., s. p.))– peu onéreux, jetables, produits en série, « franchissent des frontières impossibles, tels une Alice au pays des merveilles »((Liliana Porter, In Conversation, op. cit. p. 82)). Rien d’étonnant si Liliana cite souvent Lewis Carroll et Jorge Luis Borges au titre de ses principales sources d’influence. Circulant entre culture populaire et monde de l’art, créant un environnement dans lequel, étrangement, un dialogue se noue malgré des différences radicales, les sujets de Porter peuplent son « pays imaginaire ».

En septembre dernier, me rendant au vernissage de l’exposition Porter au Museo del Barrio, à New York, j’ai tout d’abord fait une halte la rétrospective Delacroix présentée au Metropolitan Museum. Celle-ci se conclut sur les vestiges endommagés de La Chasse au lion (1855), œuvre grandiose, extraordinaire par ses dimensions, sa passion, sa violence destructrice débridée et la dense intrication de ses surfaces colorées. Arrivée dans l’exposition de Liliana, plus au nord de Manhattan, j’y ai vu To Sweep [« Balayer »], vaste toile blanche dont l’unique image figure dans la partie centrale, où une brosse semblable à celles utilisées pour nettoyer les baignoires a balayé comme les rafales de vent d’un ouragan une kyrielle de minuscules objets en plastique, écrasant chevaux, voitures et autres tchotchkes plus triviaux sous un déluge de peinture. Vide, quand le tableau de Delacroix était plein à craquer, au « contenu » minuscule, en plastique, difficile à identifier, au caractère parfois plutôt domestique que monumental ou dramatique, l’œuvre de Porter m’a sidérée. C’était le corollaire exact de La Chasse au lion, une mise en image de la destruction, un récit narré à partir d’un autre point de vue (plus féminin, et ironique), une œuvre réalisée de manière à impliquer non des bêtes fauves, mais les plus humbles d’entre nous.
Ana Mendieta
Cuba New York Rome
She found her roots here((« C’est ici qu’elle trouva ses racines » – Plaque commémorative apposée à l’Académie américaine de Rome composée par Raquel, la sœur d’Ana ; in. Jane Blocker, Where is Ana Mendieta? Identity, Performativity, and Exile (Durham et Londres : Duke University Press, 1999), p. 106. Par parenthèse, ce titre est réellement l’un des grands ouvrages de la critique contemporaine.))
Le chez-soi ‒ et sa nature insaisissable ‒ constitue un thème important dans l’art de Liliana Porter comme dans celui d’Ana Mendieta. Pour Porter, c’est un ancrage, mais inaccessible. Ses minuscules figurines peintes s’efforcent parfois de franchir de vastes paysages, aspirant à atteindre quelque destination domestique hors de portée. À l’instar de la pensée de Buenos Aires, l’idée de chez-soi, toujours présente chez Porter, plane au-dessus de modalités toujours plus abstraites en apparence. En 2007, elle crée une toile de grandes dimensions figurant un petit cottage sur un fond presque blanc, qu’elle réutilise en différents formats (installations, photographies), laissant la structure fonctionner comme au sein d’une mise en abyme qui n’est pas sans rappeler Things are Queer, la séquence photographique réalisée par Duane Michals en 1973. Intitulée The Resemblance, la maison peinte semble flotter dans le paysage pictural au sein duquel elle est incluse. Son échelle suscite une impression d’intimité et de proximité, tandis que son environnement crée l’illusion d’une expansion où elle paraît se renfoncer, distante, presque hors de portée. Cette petite habitation et la dissonance spatiale qui la cerne occupaient mes pensées le jour où je visitai l’atelier de Porter à Rhinebeck, New York. Chez elle, en regardant par la fenêtre, je repérai une construction identique : petite, blanche et, en effet, simultanément proche et lointaine, son éloignement étant véritablement, inexplicablement difficile à estimer. J’en eu le souffle coupé ; Porter éclata de rire. Je me demandais si l’art avait imité la vie, ou s’il se contentait de me jouer des tours, d’abuser mes yeux et mon esprit.
Liliana aime récupérer et conserver toutes sortes d’objets, pas seulement le bric-à-brac qui peuple ses œuvres, mais également sa correspondance. Elle détient dans ses archives plusieurs cartes postales signées d’Ana, probablement écrites à Rome quand Mendieta y séjournait et travaillait, mais expédiées par les services postaux des États-Unis. (Dans les années 1970 et 1980, les Américains qui voyageaient à l’étranger avaient coutume d’écrire leurs cartes postales dans les pays où ils séjournaient, mais de les rapporter aux États-Unis avant de les adresser à leurs amis, évitant ainsi d’onéreux frais postaux et les retards.) Seule une des trois cartes postales touristiques que Porter m’a montrées a un lien direct avec l’Italie. L’une figure un perroquet dans un paysage de jungle tropicale, la deuxième l’hôtel Amstel à Amsterdam, la dernière la sculpture Cupidon et Psyché conservée aux musées du Capitole à Rome. Au revers de ces trois cartes postales, Mendieta évoque ses pérégrinations, son travail, des pensées sur ses relations, ses sentiments et sa vie quotidienne. À l’époque citoyenne américaine, écrivant à son amie argentine résidant à Manhattan, Ana a recours au courrier postal pour exprimer depuis son atelier romain son aversion du mercantilisme qui envahissait New York. Ayant choisi une existence nomade, faite d’espaces changeants et de frontières insaisissables, Mendieta séjournait assez librement dans les failles situées entre le proche et le lointain. À l’instar des voyageurs de Porter, systématiquement positionnés à la fois à proximité et hors de portée, les voyages étaient pour Ana un moyen de s’enraciner dans les interstices séparant les lieux, de déplacer les cibles affectives et de franchir des frontières impossibles((Liliana Porter, in Liliana Porter, In Conversation with/En Conversación Con Inés Katzenstein, – New York, Caracas : Fundación Cisneros, 2013 –, p. 82)). C’était, comme le fait observer Jane Blocker, une façon de « faire de l’exil son chez-soi »((Jane Blocker, ibid., p. 78)).

Alors que Porter recourt à son art pour créer une arène propice aux rencontres, celui de Mendieta visualisait l’absence. C’est le cas dès ses toutes premières œuvres, des performances photographiées ou filmées, où des indices éparpillés dans sa chambre ou dans la rue signalent que des événements violents ont dû se produire ‒ hors cadre, dans le passé. Ana a choisi de recourir à la photographie pour manifester ce que Roland Barthes appelle, dans La Chambre claire, le noème((Roland Barthes, La chambre claire (Paris : Éditions de l’Étoile, Gallimard, Le Seuil, 1980), p. 120)) de la Photographie : le fait que ce que l’on perçoit en regardant n’importe quelle photographie était naguère présent, mais ne l’est plus. De ce point de vue, une photographie ne peut qu’attester d’une absence ; c’est la preuve que ce qui est sous nos yeux « a été ». Pour Barthes, à la fin de sa vie, l’essence de la photographie était, avant tout, le Temps ainsi que ses mystérieux et étranges déplacements. Pour Ana Mendieta, exilée, ayant dû quitter Cuba, son pays et sa famille à l’âge de 12 ans pour des raisons politiques, puis placée, adolescente, en famille d’accueil aux États-Unis, privée de tout ce qui lui était familier (y compris de sa langue maternelle), les interruptions temporelles représentaient un sujet puissant.
Des critiques comme la remarquable Jane Blocker envisagent à travers ce prisme les Silhuetas d’Ana ‒ dessins à même le sol ou bas-reliefs gravés, que Mendieta a tracés sur la base d’un vague contour de son propre corps, en Iowa, au Mexique, à Cuba et ailleurs, et que nous connaissons principalement par la photographie. Doubles fantomatiques de l’artiste, ils font allusion à sa présence tout en signifiant son absence. « Dans ces ombres » écrit Blocker, « elle est toujours déjà ailleurs. Elles ne peuvent nous dire qui elle fut, mais seulement là où elle fut. Elles nous obligent à nous demander : “Où est Ana Mendieta ?”((Jane Blocker, op. cit., p. 99)) » Les commentateurs de son œuvre en repèrent l’origine dans le traumatisme de l’exil, comme si sa vie avait commencé dans le bouleversement de la rencontre d’une nouvelle culture à l’âge de douze ans. Mais peut-être ce choc a-t-il agi d’une autre manière, plus constructive, comme une ouverture vers une perspective plus vaste. Peut-être lui a-t-il fourni l’occasion de choisir de ne pas s’intégrer, d’« inventer son propre pays », d’imaginer un territoire conceptuel né de la multiplicité et consolidé moins par ruptures que par accrétions. C’est un aspect auquel Liliana Porter attache beaucoup d’importance, car elle établit un parallèle entre sa vision des choses et celle de Mendieta. « En grandissant aux États-Unis » a-t-elle déclaré à Sean O’Hagen dans un entretien, « Ana a sciemment conservé son identité et sa culture tout en s’intégrant aux nouveaux codes. Elle parlait parfaitement anglais. Son art reflète toutes ces questions et toutes ces situations. »((Liliana Porter, « Questions about Ana Mendieta », entretien par courriel mené par Sean O’Hagen du quotidien The Guardian, 10 septembre 2013)) Selon Porter, l’existence d’Ana ne s’inscrivait pas dans un système de choix s’excluant l’un l’autre ; elle était synthétique, cumulative, stratifiée comme un collage. Liliana m’a assuré que Mendieta n’ignorait pas comment tirer parti de son héritage latino-américain dans les milieux artistiques internationaux qu’elle fréquentait.

Sous cette perspective, les traces (performances, dessins, sculptures, photographies et films) qui désignent là où Ana « a été » ‒ spatialement, temporellement, géographiquement, culturellement ‒ créent ensemble un réseau reliant son corps à une multitudes de cultures, à l’histoire, à l’avenir, à la terre. Dans ce champ d’action, ses œuvres peuvent être interprétées comme précurseur de Disappeared Quipu de Cecilia Vicuña. Elles n’avaient pas été conçues dans l’intention de retrouver un passé perdu, de devenir déesse féministe ou de fusionner avec une nature vide de culture. Jamais nostalgique, l’art de Mendieta « passait au-dessus du temps et à travers le temps ; elle lui donnait une forme physique. En inscrivant sa silhouette dans ce paysage archéologique, c’était comme si l’artiste avait subtilement fusionné avec cet endroit et son passé. La silhouette opérait comme une artiste, au présent, avec des gestes et des méthodes artistiques contemporains, mais elle était reliée comme par magie au passé, la culture antique de Yágul. Cette image était physique. Elle était temporelle. Elle venait de la terre. Elle était d’ordre spirituel. »((Howard Oransky, « Avant-propos », in Le temps et l’histoire me recouvrent : les films d’Ana Mendieta, cat. d’exp. (Paris, Éditions du Jeu de Paume, 2018), traduit de l’anglais par Marie-Mathilde Bortolotti)) Son art était multidimensionnel et multilingue, ses significations aussi insaisissables et éphémères que les Silhuetas emportées par la mer ou effacées par le feu et la fumée. Comme les cordes à nœuds quipu de Vicuña, les traces d’Ana « commençaient en disparaissant ». Elles ont « donné naissance » à la mobilité de son corps, à son enracinement dans un espace-temps élargi et virtuel. De ce point de vue, c’est la douloureuse expérience de l’exil qui a permis à Mendieta, à l’instar de Liliana et de Cecilia, de se détacher sans se désamarrer, de vivre en permanence dans les failles entre lieux et langues, cultures et moments historiques. Son art était sa carte postale, envoyée pour nous décrire, à ceux d’entre nous qui étaient restés chez eux, cet espace changeant, aux frontières insaisissables.

« Les déplacements constants, les actes continuels de disparition qui ont laissé la preuve qu’ils ont eu lieu, toutes ces plaies ouvertes, découpées en silhouettes, encore et toujours. Les choses s’épuisent, se consument d’elles-mêmes. Le film nous contraint à souffrir ces modalités, exilés que nous sommes de son achèvement. » Rachel Weiss((Rachel Weiss, « Des temps difficiles : visionner les films de Mendieta », in ibid., p. 52, traduit de l’anglais par Christian-Martin Diebold))
À l’époque où j’ai connu Ana, dans les années 1970, elle n’était généralement pas désignée comme cinéaste, bien que nous fussions nombreux à savoir qu’elle réalisait des films. N’étant pas particulièrement proche d’elle, mais la connaissant par l’entremise de Mary Beth Edelson, Carolee Schneeman et d’autres membres du mouvement féministe actif dans les milieux artistiques, j’ai le plus souvent été confrontée aux images représentant ses performances solitaires. C’est par la photographie que j’ai vu les témoignages, sang sur les murs et les trottoirs, gravures, dessins et sculptures gravés sur la terre, dans le sable et les vagues, sur des parois de grotte ; que j’ai vu sa chair recouverte d’herbe, de plumes, de sang, de boue et de pierres ; que j’ai, autrement dit, la multitude de traces laissées par son passage en divers lieux de différents pays, sur différents continents, à différents moments. Rituels éphémères, fixés et conservés par la grâce de l’arrêt temporel qu’opère la photographie, devenus aussi mobiles, transportables et spectraux que l’artiste elle-même.
Ce que cela signifie, bien entendu, c’est qu’Ana a récemment, à titre posthume, franchi une autre frontière : elle a élargi son répertoire, rajoutant à ses titres habituels de photographe, d’artiste de performance et de sculptrice celui de cinéaste. C’est un aspect important, car il nous oblige à repenser et à revoir son travail dans un contexte élargi qui incorporerait de façon plus évidente et plus insistante le mouvement et le temps. Car il était très difficile d’être reconnu comme cinéaste dans la sphère de la performance et de l’installation à l’époque où Ana a vécu. Les cadres se prêtant à une évaluation critique et à l’exposition d’images animées ou d’installations étaient quasi inexistants jusqu’à l’année qui a précédé la mort de Mendieta, quand le Stedelijk Museum, à Amsterdam, a mis sur pied l’exposition d’œuvres vidéo The Luminous Image. Resituant ainsi les réalisations de Mendieta, l’exposition itinérante Le temps et l’histoire me recouvrent est par conséquent notable, non seulement parce qu’elle signifie implicitement l’importance de ces œuvres, mais aussi par les efforts qui ont été déployés pour la restauration et la conservation des films. En fait, l’exposition requiert que nous réévaluions la totalité de son œuvre, et ce post-mortem, alors que sa voix s’est éteinte.

J’avance ici prudemment, car j’ignore quelle place Ana assignait réellement à ces films non montés dans son œuvre, si elle les tenait (comme certains le suggèrent) pour de simples esquisses, ou si elle aspirait à ce qu’ils soient reconnus comme autant de déclarations artistiques indépendantes. On se contentera de dire qu’elle en a réalisé suffisamment pour que leur insertion dans son œuvre puisse exercer une influence sur notre perception de Mendieta en tant qu’artiste, et qu’elle n’a cessé d’en réaliser tout au long de sa carrière. Elle a commencé par de premiers films difficiles, ayant pour objet le viol, le sang, le meurtre, la violence, le voyeurisme et l’apathie. En passant par des films réalisés dans des paysages de plein air, elle s’est détournée de la menace pour aborder le lien, le rapport. Comme Rachel Weiss l’écrit dans le catalogue : « Le site de l’intensité se délocalise vers le paysage qui ménage une interface fluide avec le corps. La membrane du moi, si dure au début, devient transactionnelle. »((Ibid., p. 60)) Les films montrent cette transaction en tant que modalité, alors qu’Ana et ses substituts ‒ les Silhuetas ‒ sont enfouies sous le monde naturel, s’écoulent avec lui ou s’y dissolvent, ce qui lui permet sans doute, ainsi qu’à nous, de vivre des unions plus primitives que celles de la citoyenneté.
La continuité de ces transactions est le point fort de ces films, mais leur flux temporel nous mène sur des chemins inattendus. À la différence de la photographie, qui fige un instant, créant un symbole fixe résumant l’expérience performative, les films existent dans ce que nous percevons comme un temps « réel ». Il y a par conséquent l’anticipation d’un arc narratif et de sa résolution ; contrairement à la photographie qui conserve le passé, le film évolue vers un futur. Mais cette résolution promise ne se matérialise jamais, elle est refoulée dans ces œuvres qui n’ont subi ni montage ni manipulation. Rachel Weiss, critique et commissaire d’exposition, a attiré l’attention sur le caractère oppressant de l’essentiel de l’œuvre filmique de Mendieta. Elle écrit que le « point de vue cyclopéen »((Ibid., p. 61 )) adopté par Mendieta détermine une fermeture au sein de l’espace ouvert du paysage, suscitant une disjonction spatiale aussi inconfortable pour le spectateur que pour l’artiste. L’autrice considère que cet espace disjoint est à l’origine de perturbations, en particulier dans ces films où le spectateur perçoit simultanément la fusion de Mendieta avec la nature et son inconfort ou son effacement physique dans celle-ci. Selon Weiss, la trêve conclue par l’être humain et la nature qu’expriment les films est « provisoire » et l’isolement de l’artiste qui en résulte, son « exil », reviendrait à « être dans un corps social au sein duquel l’artiste ne peut jamais être… L’espérance de l’union, exprimée comme une dynamique entre le soi et la nature, devient progressivement le journal de l’accumulation de faits de non-union ».((Ibid, p.61)) De son point de vue, les films attestent que le corps physique d’Ana et ses substituts ‒ enterrés, inondés, rayés, emportés par les flots ou brûlés en effigie ‒ ne peuvent parvenir à réaliser la fusion à laquelle l’artiste semble aspirer, une fusion peut-être symboliquement sous-entendue dans les œuvres photographiques et sculpturales. « Ces films font mal », écrit Weiss, et pas seulement physiquement. Ils font mal parce qu’en définitive, ils concernent l’« abandon progressif des secours du mythe… Ils nous expulsent du jardin((Ibid., p.61.)). » Films courts, ne débouchant sur rien, ils s’achèvent lorsqu’Ana disparait, ou s’en va hors champ.

Je me demande ce que Mendieta penserait de cette interprétation. Ses œuvres apparaissent dans les premiers temps de l’apogée de l’art féministe, et sont à l’origine remarquées dans le contexte du Goddess movement (« mouvement de la déesse », avec lequel elle était en profond désaccord). Ses silhouettes créées sur la roche, la terre et le sable sont alors perçues comme autant d’histoires écrites au féminin ((Note du traducteur : dans la version anglaise, le mot herstory désigne, par opposition à history, une manière d’écrire l’histoire selon un point de vue féministe. Wikipedia : L’objectif de l’herstory est de proposer une vision du passé qui met en avant le rôle des femmes alors que l’histoire telle qu’on la trouve habituellement dans les ouvrages reflète le plus souvent un point de vue masculin)), de sources d’inspiration pour des femmes s’efforçant d’exprimer l’origine antique de leur pouvoir et de guérir les blessures d’une séparation affligeant à la fois la nature et la culture. Mais notre époque est différente : situer ses films restaurés au premier plan de son œuvre, c’est ajouter un imprévu dans ce récit, une nouveauté qui entre peut-être en résonance avec la délectation que trouve Liliana Porter dans la non-intégration. Sans confirmer la fusion de Mendieta avec des rythmes universels, les films manifestent au contraire sa séparation et sa solitude.
Ana est morte en 1985, des suites d’une défenestration (après avoir été poussée ?) de l’appartement de son mari Carl Andre, situé au 34e étage, dans l’East Village. Elle est tombée sur le toit de l’épicerie du quartier, juste en face de la Tisch School of the Arts, Université de New York, où j’étais alors et suis toujours professeur. Au cœur de Manhattan, loin de la nature, son corps (d’après ceux qui ont pu voir les preuves présentées lors du procès de Carl Andre –qui fut acquitté) ressemblait étrangement à certaines de ses photographies. Ensanglanté, brisé, recouvert d’un drap, il avait laissé sa trace sur la surface du toit. La vie, comme nous le comprîmes avec effroi, avait en définitive imité l’art. Mais cette fois-ci, notre talentueuse et fougueuse amie ne se lèverait plus pour s’en aller.
Shelley Rice
Traduit de l’anglais par Christian-Martin Diebold
Visuel en page d’accueil : Ana Mendieta, Creek, 1974, film super-8 © The Estate of Ana Mendieta Collection, LLC. Courtesy Galerie Lelong & Co.
“Ana Mendieta. Le temps et l’histoire me recouvrent”/Jeu de Paume
“Liliana Porter: Other Situations”/Museo del Barrio
“Cecilia Vicuña: Disappeared Quipu”/Brooklyn Museum
Ana Mendieta/La sélection de la librairie