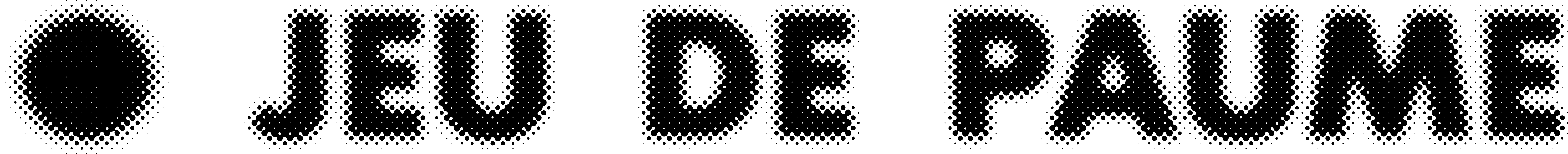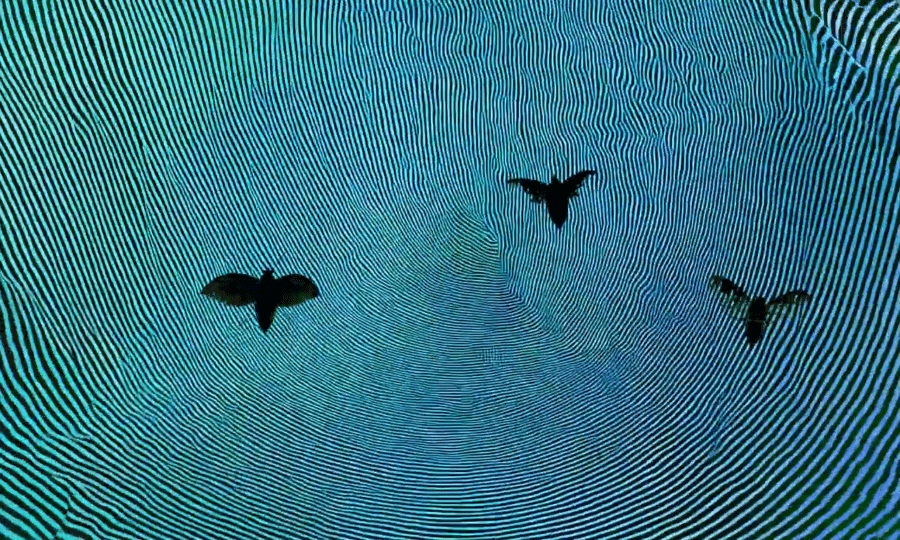
Projection
Les chambres obscures de l’IA ♯3
Video EssAI. Carte blanche au groupe de recherche-création « The Video Essay: Memories, Ecologies , Bodies »
Mardi 06 mai 2025 • 18:30
Jeu de Paume - Paris
Cette programmation de films et de rencontres conçue par Alice Leroy, critique de cinéma et chercheuse en études visuelles. explore les dimensions matérielles et sociales de l’intelligence artificielle, loin des représentations courantes du cinéma commercial qui la réduisent à une réplique du cerveau humain ou à une entité abstraite et désincarnée.
À travers des films documentaires, expérimentaux et artistiques, ce cycle déconstruit les mythes technophiles et propose d’autres récits, interrogeant notamment le caractère « artificiel » de l’IA et élargissant notre conception de l’intelligence. Chaque séance est introduite par un film plus ancien, offrant un éclairage rétrospectif sur les enjeux contemporains.
En réalisant Mothlight (1963), film sans caméra, composé d’ailes de papillons et de fleurs collées sur la pellicule, Stan Brakhage savait-il que l’une des premières failles à l’intérieur d’un système informatique en 1947 avait été causée par un papillon de nuit ? La présence impromptue de cet être minuscule conduisit les informaticiens à nommer ce type d’accidents des « bugs », preuve que la stabilité d’un système n’était jamais garantie. D’un médium à l’autre, nous voici au cœur d’une aventure perceptive entreprise par le groupe de recherche en essai vidéo pour sonder le regard de la machine aussi bien que les « failles » (glitch) que l’IA introduit dans les images cinématographiques. Réalisés sans caméra, ces essais poursuivent le geste de Brakhage en questionnant la nature des images générées par IA, leur réalisme déviant et leur propension à l’hallucination à travers l’exploration d’un imaginaire cinématographique commun. Il ne s’agit pas de célébrer ou de craindre une autonomisation des images qui tendrait à annihiler tout acte de création et tout réel, mais d’explorer la complexité de ces réseaux artificiels et de ces chaînes d’actions qui reconfigurent aujourd’hui l’histoire des images.
Au programme :
- Stan Brakhage, Mothlight (1963) 4’
- Eryk Salvaggio, Moth Glitch (2024) 3’
- Evelyn Kreutzer, Toute la data du monde (2025) 4’30
- Johannes Binotto, Along the Rim (2024) 3’
- Johannes Binotto, Not Exactly a Still Life (2024) 4’
- Gregory Chatonsky, The Kiss 3: recursive Cinema (2022) 2’41
- Quan Zhang, KwAIdan (2024) 4’53
- Kevin B. Lee, Afterlives (projet en cours) 7’
- Silvia Cipelletti, Algorithmic Borders (2025) 7’
- Marine de Dardel, (DES)ASTRES.ai (2025) 5’
- Dayna McLeod, So I didn’t sleep very well last night (2022) 3’
- Occitane Lacurie, Xena’s Body (2024) 11’40
- Roc Albalat, Latencies of the Statistical Image (2025) 9’
- Radu Jude et Vlaicu Gocea, Beginnings (2025) 18’