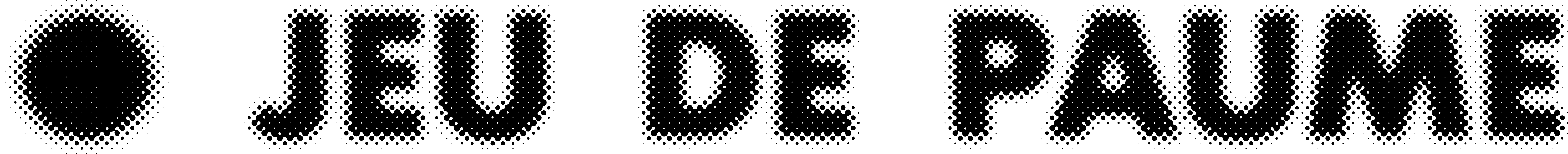Guide d'exposition
TEXTES DE SALLE
Madeleine de Sinéty. Une vie
Cette exposition, qui met en lumière plusieurs séries de photographies totalement inédites, est la première rétrospective consacrée à Madeleine de Sinéty (1934-2011), dont l’œuvre a été peu montrée de son vivant: seul son travail en noir et blanc avait été partiellement dévoilé, notamment lors d’une exposition à la Bibliothèque nationale de France en 1996 et d’une autre aux États-Unis, au Portland Museum of Art dans le Maine en 2011.
Son oeuvre, solitaire, construite à l’écart des commandes et des publications, s’est entremêlée à son quotidien et à ses allers-retours entre la France et les États-Unis. Fille d’aristocrates désargentés, élevée dans un château du Val de Loire, Madeleine de Sinéty commence son parcours artistique à Paris au milieu des années 1960 en tant que dessinatrice de mode pour des magazines. L’envie de créer semble l’avoir toujours animée; elle aurait pu écrire ou peindre, mais c’est la photographie qui conjugue le plus grand nombre de ses aspirations
et qui l’emporte. Après des études à l’École des arts décoratifs de Paris, elle commence à photographier en autodidacte, en couleurs comme en noir et blanc. Timidement d’abord, en 1970, avec des images de son quartier – celui de la gare Montparnasse, alors en pleine mutation-, puis dans les rues de New York, où elle séjourne à plusieurs reprises avec son mari Daniel Behrman, journaliste américain rencontré à Paris; autour des trains à vapeur, enfin, une passion d’enfance qu’elle prolonge ainsi avec ce médium. C’est aussi là qu’elle trouve une autre distance avec ses sujets: elle se lie d’amitié avec des cheminots, réalise leurs portraits, partage leurs temps de repos et découvre les réalités du monde ouvrier.
La production de Madeleine de Sinéty est le plus souvent indissociable de sa vie de tous les jours: dans le petit village de Poilley en Bretagne – où elle s’installe dans les années 1970 et réalise plus de 50 000 clichés sur une dizaine d’années-, comme à Rangeley aux États-Unis, lieu de résidence des vingt-cinq dernières années de sa vie. Elle y photographie de l’intérieur les communautés qui l’ont adoptée – proches, familles, amis et connaissances-, les activités et événements, ainsi que le rythme des saisons. Dans un constant souci de documenter et de témoigner, elle capture les coutumes, gestes, lieux, pratiques – pour beaucoup amenés à disparaître-, tentant.jour après jour et avec un brin de nostalgie, d’en retenir la grâce fugitive et les couleurs fragiles. Cette soif de mémoire et de souvenirs se retrouve dans le journal intime qu’elle a tenu à divers moments de sa vie et dont quelques extraits sont présentés dans l’exposition, en contrepoint de ses photographies.
Vapeurs, 1970-1974
À partir de 1969, Madeleine de Sinéty et son compagnon, le journaliste Daniel Behrman, commencent à parcourir les gares et les lignes secondaires de chemin de fer, animés d’un même enthousiasme pour les derniers trains à vapeur encore en circulation. Ceuxci incarnaient pour eux une dimension romantique du voyage, difficile à se figurer aujourd’hui tant le transport ferroviaire s’est banalisé et l’imaginaire de l’ailleurs a été relégué à des horizons toujours plus lointains. La passion des machines et l’évocation nostalgique des voyages se sont rapidement étendues aux cheminots et à la découverte du monde ouvrier français et de ses réalités.
À la gare Montparnasse, le couple fait connaissance et se lie d’amitié avec une équipe de machinistes qui l’autorisera — au détour de passages à niveau peu fréquentés — à monter clandestinement dans la cabine du conducteur et à réaliser les premiers clichés de leur reportage. Munie de son premier appareil 35 mm, la photographe alterne noir et blanc et diapositives Kodachrome, capturant portraits, natures mortes et paysages. Elle accumule ainsi des milliers de vues de locomotives ou de leurs tourbillons de flammes et de fumée, saisissant la relation presque organique des mécaniciens à la machine, qui souffle, respire, peine, crache du feu ou de la vapeur. Les liens tissés autour de ce projet seront déterminants. Ils l’amèneront ensuite vers la Bretagne afin de suivre une équipe de cheminots dans les Côtesd’Armor, où elle choisira d’établir sa résidence pour se vouer entièrement à la photographie. Plusieurs de ces images de trains paraîtront dans des articles de la revue Réalités au cours des années 1970 et, en 1997, Madeleine de Sinéty y consacrera le livre Guingamp- Paimpol : deux minutes d’arrêt
Paris démoli, 1970-1975
Au début des années 1970, parallèlement à son travail sur le monde des cheminots, Madeleine de Sinéty prolonge ses premiers essais photographiques autour du boulevard Edgar-Quinet, dans le 14e arrondissement parisien où elle habite, à deux pas du chantier pharaonique de la nouvelle gare et de la tour Montparnasse. Le secteur, alors vivant et mêlant artistes, ateliers, petits cafés et immeubles anciens, est en passe d’être sacrifié à la promesse de la modernité pour devenir un complexe urbain de béton et de verre. Dans son journal, l’artiste résume son aversion pour la tour Montparnasse, en la qualifiant de « mirador de cauchemar ». C’est sous le titre « Paris démoli » qu’elle regroupera ces images d’une ville où les rues sont encore marquées par la présence des classes populaires, de cafés ouvriers, d’enfants qui jouent, et dont elle aimerait pouvoir conserver la mémoire.
Dans ses déambulations photographiques, elle collectionnera aussi les reproductions des affiches des collectifs de riverains, signes de la lutte contre les expulsions et les phénomènes de gentrification à l’oeuvre. Le quartier regorge de nombreux ateliers d’artistes que Madeleine de Sinéty fréquente pour des cours du soir, pendant lesquels de vieux maîtres enseignent le dessin de nu académique devant des modèles las. Madeleine de Sinéty, qui travaille alors depuis une quinzaine d’années pour des magazines de mode et évolue dans le milieu aristocratique parisien, semble rechercher une voix plus intime de création. Elle s’interroge dans son journal, le 10 novembre 1972 : « Peutêtre devrais-je ne faire que de la photo, pas du dessin ? Et pourtant j’aimerais bien pouvoir rendre la vie avec un bout de papier et un crayon, la photo n’est que plus rapide que mes mains, ce que je vois, c’est pareil et ce sont les mêmes choses qui me touchent. »
New York, 1972-1978
Daniel Behrman est originaire de New York, où le couple séjourne à plusieurs reprises au cours des années 1970, y compris après la naissance de Thomas. La ville, où la crise économique fait rage et le chômage comme la criminalité sont élevés, est alors en pleine mutation et il suffit de se déplacer de quelques rues pour que l’ambiance change du tout au tout. Inauguré en 1973, le World Trade Center redessine la silhouette du sud de Manhattan, où Madeleine de Sinéty déambule au petit matin, attirée tout particulièrement par les activités du Meatpacking District.
À une période où, à Paris, les Halles viennent d’être détruites et transférées hors de la capitale, la photographe semble fascinée par le maintien au coeur de la ville, pour quelques années encore, de ce marché de grossistes en viande, où l’on conditionne et revend : on peut y voir des carcasses d’animaux chargées dans le coffre d’une voiture, tandis que, plus loin, le chariot à bras garni de fruits d’un marchand s’illumine d’une lumière théâtrale. Les petits vendeurs, des ouvriers, quelques sans-abris se réchauffent autour des feux improvisés sous la voie ferrée aérienne. C’est ici, par train, que la ville est approvisionnée. Madeleine de Sinéty décide de tourner son objectif vers ces travailleurs. Est-ce parce qu’elle pressent la fragilité de leur existence ou de leur activité ? Ou simplement par altérité, car c’est d’eux qu’elle veut se sentir proche ?
Un village, 1972-1991
En 1971, Madeleine de Sinéty passe quelques mois dans la commune de Lanloup, en Bretagne, où elle côtoie des pêcheurs et des agriculteurs. Rejoignant Paris après un séjour dans la région à l’été 1972, elle fait étape à Poilley, en Ille-et-Vilaine, à soixante kilomètres au nord de Rennes : c’est le coup de foudre. L’odeur des foins, le bruit des charrettes et des chevaux lui rappellent ceux de la ferme du château de son enfance, dont l’accès lui était pourtant formellement défendu, comme à tous les enfants du comte et de la comtesse. Mais elle a maintenant 37 ans, et plus personne ne lui interdira rien. Elle comprend que c’est là qu’elle veut vivre et créer.
Elle met dès lors fin à ses engagements d’illustratrice et s’installe pour huit ans dans une maison de ce village de 500 habitants. Madeleine de Sinéty y fait la connaissance de Marie Touchard et de sa petite-fille Béatrice, qui deviendront ses amies et la clé d’entrée dans cette communauté composée d’une vingtaine de fermes, d’une école, ainsi que de quelques bistrots et commerces organisés autour d’une église en granit et de son cimetière. Elle va habiter ici, aider aux travaux des champs et de la ferme, son appareil photo autour du cou, tous les jours et en toutes saisons. Avec le temps, elle est acceptée de tous et, même si elle intrigue et qu’on a bien conscience de sa différence, on la laisse photographier l’intérieur des maisons, les fêtes de village, les mariages…
De temps en temps, elle projette ses images dans la salle des fêtes, donnant l’occasion aux habitants de se découvrir, surpris, selon leurs propres mots, de se trouver si beaux et dignes d’être représentés. Le monde rural est en pleine mutation ; bientôt adviendront la mécanisation de l’agriculture et l’optimisation forcée des parcelles par le remembrement — les paysans deviendront des exploitants agricoles et l’agriculture, une industrie. Mais il est encore temps de fixer ces gestes : la mort du cochon, le travail avec les bêtes, la récolte… 33 280 diapositives couleur, 23 076 négatifs noir et blanc : c’est par cette liste qu’aurait pu commencer l’une des centaines de pages du journal intime tenu par Madeleine de Sinéty. La qualité de sa relation aux êtres photographiés, l’intimité, la richesse et la diversité des rencontres débordent de toutes parts de cette accumulation d’images. La photographe aura vécu à Poilley de 1972 à 1980. Elle y fera par la suite de nombreux voyages depuis les États-Unis.
Maine, États-Unis, 1986-2001
Après avoir vécu cinq ans en Californie, Madeleine de Sinéty s’établit à Rangeley, dans le Maine, avec sa famille en 1985. C’est l’Amérique rurale, sans aucune grande ville alentour, des forêts profondes, une station de ski à proximité, un lac… Des hivers rugueux, mais surtout une atmosphère traditionnelle, avec une communauté soudée où tout le monde se connaît — souvent depuis toujours. On se retrouve autour de l’école, du terrain de football et des matchs du vendredi soir, près de l’église, dans les parades ou les foires agricoles. Le tourisme et l’exploitation des forêts voisines font vivre cette ville d’un millier d’habitants. L’accent français à couper au couteau de Madeleine de Sinéty ne l’empêche pas de s’intégrer rapidement et de devenir la photographe attitrée des rituels familiaux : mariages, remises de diplômes, sorties scolaires…
Elle partage son temps entre ses deux enfants, Thomas et Peter, et son travail. Elle collabore également avec le journal local The Rangeley Highlander, dont les bureaux se situent en face de chez elle. En 1986, à l’occasion d’un atelier à Rockport (Maine), elle rencontre la célèbre photographe américaine Mary Ellen Mark. Les deux femmes se lient d’amitié, et celle-ci, demeurant par la suite un soutien et une influence forte pour Madeleine de Sinéty, l’aidera à sélectionner ses images de Poilley. À côté des commandes — clichés de l’intimé des foyers ou de la vie de la communauté de Rangeley —, Madeleine de Sinéty poursuit des projets personnels dans l’État du Maine, documentant, essentiellement en noir et blanc dorénavant, certains métiers qui disparaissent et le quotidien de familles monoparentales dépendant de l’aide sociale.