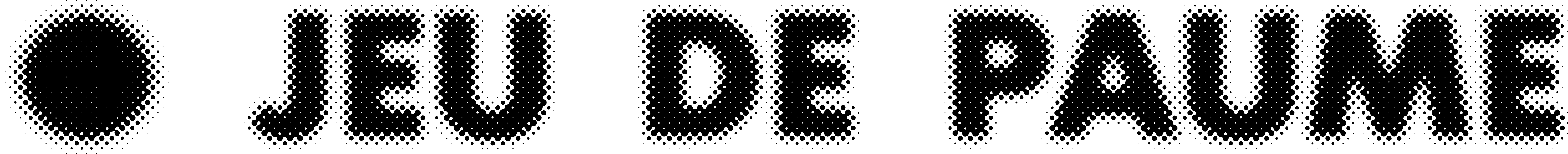Archive magazine (2009 – 2021)
Luigi Ghirri : « L'œuvre ouverte »
« Je pense que la photographie, par-delà toutes les explications critiques et intellectuelles, indépendamment de tous ses aspects négatifs, est un langage visuel formidable pour pouvoir amplifier le désir d’infini qui est en chacun de nous. »
Aujourd’hui, mardi 30 octobre 1984.
J’écris ces pages après avoir longuement réfléchi, ces derniers jours, pour tâcher d’expliquer l’œuvre photographique, pour trouver une définition.
Ce n’est pas facile pour moi, bien que j’aie toujours pensé à l’œuvre photographique depuis mes débuts.
Et peut-être même encore avant, quand j’étais enfant et que je regardais l’album de famille ou l’atlas géographique, un très bel atlas où les cartes géographiques alternaient avec des pages remplies de photographies du monde entier.
Une petite bible laïque à usage privé et une grande bible publique, avec l’histoire et les lieux des autres.
Telle a peut-être été ma première rencontre avec l’œuvre photographique. Ces deux livres, si courants, apparemment banals, contenaient les deux catégories du monde et le représentaient comme je l’entendais : l’intérieur et l’extérieur, mon lieu et mon histoire, les lieux et l’histoire du monde.
Un livre pour rester et un livre pour aller.
Dans mon travail, dès le début, j’ai essayé de concilier ce dualisme, de réduire cette fracture ou cette division entre l’intérieur et l’extérieur, entre mon histoire personnelle et la communication avec mon prochain.
Ces deux mondes ne devaient pas être séparés et ces deux catégories non communicantes : ils devaient trouver des relations, des intuitions et même des contradictions pour atteindre, si possible, un rapport d’équilibre magique. Et c’est précisément en vue de cette recherche d’unité et de complétude que j’ai tout de suite pensé à une unique, grande œuvre.
J’ai ainsi écarté, immédiatement, l’idée de faire des photographies comme pour rassembler de nombreux objets déconnectés et sans rapports les uns avec les autres ; je n’ai pas accepté l’idée que le hasard, éventuellement soutenu par une plus ou moins grande habileté, puisse devenir l’épine dorsale de mon travail de photographe.
Comme je l’ai déjà écrit en d’autres occasions, je ne me suis jamais intéressé aux images définitives et décisives, à l’étude du langage, aux lignes analytiques, au concept ou à l’idée totalisante, à l’émotion et à la citation, à la recherche d’un nouveau crédo esthétique, à l’usage d’un style. Au lieu de cela, j’ai essayé de séparer ces valeurs et de les considérer ensuite globalement comme une modalité opérationnelle.
De ma part, il ne s’agit pas d’un choix pour le grandiose ou la monumentalité, pour l’amour masochiste de la difficulté : c’est le choix de la complexité, comme conscience des potentialités infinies de la photographie.
Freud a dit que nous pourrions représenter l’instrument qui exécute nos fonctions mentales comme quelque chose qui ressemble à un microscope composite ou à un appareil photographique.
Cette affirmation me semble correspondre à ce que je disais et à ce que j’ai toujours pensé de la photographie, cette source inépuisable de stimuli, de sensations, d’interrogations, de réponses, et non pas de morcellement de la vision. La photographie comme une grande aventure de la pensée et du regard. On a qualifié plusieurs fois mon travail d’intellectuel – non sans une subtile désapprobation –, de conceptuel, de surréel, de pop, de réaliste, d’hyperréaliste, de postmoderne, etc.
Je crois qu’aucun adjectif n’est précis et qu’aucun n’est imprécis. C’est que peut-être mon idée de la photographie, comme inépuisable possibilité d’expression, a cherché dans la réalité à la fois des mondes, et des moyens de les représenter. J’ai essayé de ne pas me réfugier dans les territoires solides de la répétition de moi-même, mais j’ai cherché à chaque fois des modalités de regard et de fonctionnement différentes.
Je pense que la photographie, par-delà toutes les explications critiques et intellectuelles, indépendamment de tous ses aspects négatifs, est un langage visuel formidable pour pouvoir amplifier le désir d’infini qui est en chacun de nous.
Comme je l’ai dit plus haut, une grande aventure du monde de la pensée et du regard, un grand jouet magique qui parvient à conjuguer miraculeusement notre conscience adulte et le monde enchanté de l’enfance, un voyage continuel dans le grand et dans le petit, dans les variations, à travers le royaume des illusions et des apparences, ce lieu labyrinthique et spéculaire de la multitude et de la simulation.
Borges parle d’un peintre qui voulait peindre le monde et qui commence à faire des tableaux avec des lacs, des montagnes, des bateaux, des animaux, des visages, des objets. À la fin de sa vie, en réunissant tous ces tableaux et ces dessins, il s’aperçoit que cette immense mosaïque était son visage.
L’idée de départ de mon projet-œuvre photographique peut être comparée à ce récit. C’est-à-dire que c’est l’intention de trouver une figure, une structure pour chaque image, laquelle, prise dans son ensemble, en détermine toutefois une autre. Un fil ténu qui lie l’autobiographie et l’extérieur.
C’est pour cela que j’ai toujours travaillé sur un projet (de départ) qui ne doit pas rester un schéma rigide, mais qui doit être ouvert aux intuitions et aux hasards que je rencontre au cours de mon travail.
Cette manière d’encastrer que je peux qualifier de montage, ressemble à la méthode de construction d’une mosaïque ou d’un puzzle. En n’oubliant jamais que si l’image n’est terminée qu’à la fin, chaque image doit quand même avoir une autonomie et une validité propres.
J’ai fait porter mon attention sur une immense quantité de sujets, non pas par désir de tout comprendre, mais pour la curiosité de comprendre tout ce qu’il m’était et qu’il m’est possible de comprendre.
Je pourrais énumérer les sujets qui reviennent le plus fréquemment, ceux qui sont un peu comme un leitmotiv de mon œuvre, tout comme je pourrais énumérer les modes de construction de l’image, mais je préfère souligner une constante de mon travail, ce que je pourrais appeler un invariant.
J’ai toujours pensé que la photographie était un langage pour voir et non pas pour transformer, occulter, modifier la réalité.
J’ai laissé sa magie révéler à notre regard les espaces, les objets, les paysages que je veux représenter.
Convaincu qu’un regard libre d’acrobaties formelles, de formes de coercition et d’élucubrations arrive à trouver un équilibre entre conscience et simplicité.
Trouver ainsi, à l’intérieur de la géométrie et de la fixité de l’espace de la chambre noire, la mesure de la représentation de l’extérieur.
Aucune violence, aucun choc visuel-émotionnel et aucune exagération, mais le silence, la légèreté et la rigueur pour pouvoir entrer en relation avec les choses, les objets, les lieux.
En ce sens, je pourrais dire que la connaissance de Walker Evans, l’auteur que j’aime et dont, plus que tout autre, je me sens proche, m’a beaucoup aidé.
Je ne pourrais pas dire qui m’a influencé, car ils sont trop nombreux pour que je les mentionne tous et je pourrais en omettre quelques-uns. Il est facile de se rappeler certains d’entre eux, mais que dire des visages dont on n’arrive pas à se souvenir, que dire des tournants, des coins, des raccourcis qui disparaissent à notre vue et que nous laissons derrière nous, que dire des disques que nous n’avons écoutés qu’une seule fois. Nous ouvrons les yeux et les oreilles, et nous sommes influencés, et nous ne pouvons vraiment rien y faire.
Ces mots sont de Bob Dylan, un autre auteur que j’aime beaucoup, qui peut aider à clarifier ce que je pense du problème des influences, des priorités, de l’originalité, si cher à tant de photographes.
Il y a une grande partie du monde de la photographie avec laquelle je n’ai jamais été vraiment d’accord.
Trop souvent, celle-ci décline ses potentialités, pour se réfugier dans l’émotion de la couleur, dans la répétition obsessionnelle, dans l’utilisation répétée et finalement lassante du style, dans le catalogage, dans les exagérations formelles.
Certains aspects maniaques me semblent dangereux : la photographie comme aphasie de la vision, comme antichambre pour l’anesthésie du regard. La nécessité d’être originaux, créatifs à tout prix, la recherche désespérée de la nouveauté et d’une marque de fabrique, en croyant que l’on peut reconnaître un auteur parce qu’il imprime une marque visuelle sur le monde extérieur. Au lieu d’essayer d’introduire des modalités et des temps nouveaux dans sa pratique, la photographie est entrée dans l’espace rigide de la reproduction de soi-même. Peut-être est-ce Shakespeare qui s’impose ici : « Quelle ironie du sort, avoir une si bonne vue et entrer dans une ruelle aveugle ! » C’est que nous avons malheureusement assisté au cours des dernières années à la colonisation totale du concept de créativité dans la photographie. Une créativité stéréotypée a fait oublier les problèmes fondamentaux du travail du photographe, une sorte de court-circuit a interrompu le dialogue avec la réalité, au profit d’un monologue entre des miroirs.
Je pense aujourd’hui que mon projet n’a pas tellement changé, peut-être même s’est-il précisé.
J’ai pris note du fait qu’en très peu de temps, beaucoup d’idées et de formes se sont brisées et ont pris fin ; mais quant à la colonne vertébrale de mon travail, il n’y a pas eu de changements majeurs.
Les techniques visuelles récentes ont provoqué une transformation de la qualité du regard, les images électroniques, les techniques vidéo semblent reléguer la photographie au grenier des antiquités ; mais, malgré tout, je crois qu’elle a encore un vaste espace devant elle. Les lieux, l’extérieur, l’intérieur, tout semble traversé par des stimuli visuels de plus en plus rapides et fréquents, mais tout cela nous empêche de voir clairement. Au milieu de cette mer hétérogène, dans ces lieux qui sont de plus en plus soumis à la domination totale du « territoire de l’analogue » et où la multiplication suit un rythme de plus en plus vertigineux, nous pouvons considérer la photographie comme un moment important de pause et de réflexion. La photographie, donc, comme moment de réactivation des circuits de l’attention, que la vitesse de l’extérieur avait fait sauter.
Je ne crois pas que tout cela soit un grand, un colossal paysage de passage, et que tout soit en train de disparaître à notre regard, mais nous devons passer de la photographie de recherche à la recherche de la photographie.
Rechercher une photographie qui indique de nouvelles méthodes pour voir, de nouveaux alphabets visuels, mais surtout une photographie qui ait comme présupposé un état de nécessité. Rechercher une photographie qui instaure de nouveaux rapports dialectiques entre l’auteur et l’extérieur, de nouvelles voies, de nouveaux concepts, de nouvelles idées, pour entrer en relation avec le monde, chercher des moyens appropriés de le représenter, pour restituer des images, des figures, pour que photographier le monde soit aussi une manière de le comprendre.
Rechercher une photographie qui soit aussi une méthode pour organiser le regard, à la fois rapide comme les images cinématographiques, et statique comme la représentation picturale. Le secret subtil qui nous fascine dans la photographie, c’est peut-être qu’elle est une parfaite synthèse entre des états de calme et de mouvement.
Mon idée d’une œuvre photographique est le fruit de toutes ces considérations, c’est l’idée d’une œuvre ouverte. Non pas qu’il manque simplement quelques pièces pour terminer le puzzle, mais parce que chaque travail s’ouvre sur un espace élastique, il ne se réduit pas à une entité mesurable : il déborde, c’est un dialogue continuel entre celui qui est terminé et celui qui sera.
L’image acquiert ainsi des contours moins définis, catégoriques et lapidaires, pour faire partie d’une organisation plus grande et en mouvement constant.
Mon rêve n’est pas celui de Mallarmé et de son grand livre, même si en le paraphrasant, on a écrit : « que tout au monde semble exister pour aboutir à une photographie. » C’est peut-être tout simplement l’idée de construire un livre, ou plutôt une sorte d’Atlas Personnel, la symbiose parfaite des deux livres que j’évoquais au début.
Luigi Ghirri
Luigi Ghirri, L’opera aperta, texte dactylographié, 1984 © Succession Luigi Ghirri.
Première publication In. Paolo Costantini, Giovanni Chiaramonte, Niente di Antico Sotto Il Sole [Rien d’ancien sous le soleil], Società Editrice Internazionale, Turin, 1997.
Traduction de l’Italien pour le magazine du Jeu de Paume : Jérôme Thomas.
Reproduction en français avec l’aimable autorisation de la Succession Luigi Ghirri. Remerciements à Adele Ghirri et Maria Fontana.
Image en page d’accueil : Luigi Ghirri, Modena, 1972. CSAC, Università di Parma © Succession Luigi Ghirri
« Luigi Ghirri. Cartes et territoires »
La sélection de la librairie