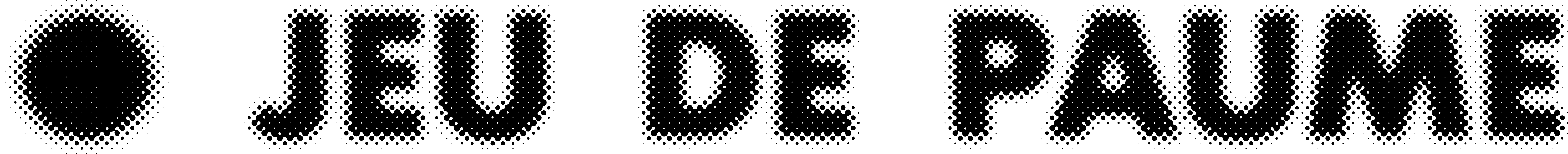Archive magazine (2009 – 2021)
Marina Vinyes Albes : “Un bal de silhouettes”
Des femmes qui avancent frontalement et avec détermination vers celui qui les observe : Où sont-ils ?
1. La question nous interpelle immédiatement; certaines d’entre elles nous regardent à leur tour, avec dureté.
Les corps tendus soulèvent le portrait des membres disparus de leur famille. Certaines lèvent les bras très haut, tout comme le fait de manière fraternelle une statue située en arrière-plan de la photo d’Eduardo Gil. Un geste de protestation qui aurait pu être – qui est aussi – un geste désespéré, un cri de douleur vers le ciel.

2. Peu après le coup d’État militaire survenu au Chili le 11 septembre 1973, des ateliers clandestins constitués uniquement de femmes et consacrés à la confection d’arpilleras ont été créés dans la ville de Santiago. Leur origine remonte au Regroupement de parents de détenus disparus1, la même qu’on utilise pour emballer des marchandises comme le blé ou la farine. Elles se rassemblent, partagent leurs expériences et leurs silences, imaginent et apprennent à exprimer leur douleur en cousant, en coupant et en collant : les choses vues, ressenties et ce qu’elles n’aiment pas. Peu à peu, les arpilleras se transformeront aussi en de fermes dénonciations de la dictature. Alors que le régime et la presse conservatrice les condamnent publiquement en tant que matériel subversif ou napperons diffamatoires contre le Chili((Cf. La Segunda, 16 avril 1980 ; La Segunda, 26 juillet 1978; El Mercurio, 13-19 août 1978)), beaucoup de ces œuvres – la plus grande partie – commencent à quitter le pays grâce au soutien d’organisations solidaires, et les femmes reçoivent en échange des revenus qui leur permettent de subsister. Comme des papillons ((Georges Didi-Huberman : “Le message des papillons”, publié à l’origine dans P. Turlais : Tracts et papillons de la résistance, Paris, éditions Artulis, 2016. Disponible sur le site web : http://resistance.editionsartulis.fr/)), elles s’envolent pour aller porter leur témoignage à travers le monde.
Comme en écho à l’arpillera ci-dessous, la photographie d’Eduardo Gil immortalise la deuxième Marche de la résistance à Buenos Aires, en 1982, alors que la dictature n’est pas encore terminée. Dans ce contexte, prendre une photo, tout comme coudre, suppose de prendre des risques, de s’exposer. Ainsi le confirme son cadrage, prise de position ((Cf.Georges Didi-Huberman : Quand les images prennent position. L’œil de l’histoire, 1, Paris, éditions de Minuit, coll. “Paradoxe”, 2009)) éloquente.
L’arpillera chilienne et la photographie argentine montrent des gestes de soulèvement et sont, en elles-mêmes, un geste de soulèvement.
3. L’arpillera naît de la douleur propre de chacune, quand la photographie prend position devant la douleur des autres.
C’est de cette profonde émotion face à la perte d’un fils ou d’une fille, d’un compagnon, d’un frère ou d’une sœur, que le deuil se transforme en création. Ces tapisseries sont le résultat de ce qu’ont vu et ce qu’on dit pour la première fois celles qui n’avaient ni parole ni présence dans l’espace public ; des voix puissantes qui protestent depuis une indignation partagée, qui naît de la plainte et se transforme en un langage inédit. Ainsi, le deuil et la résistance convergent dans un même acte : leur désobéissance commence en pleurant les corps absents dans le but de leur restituer leur dignité, la valeur brutalement soustraite d’une vie qui a de l’importance ((Cf. J. Butler : Ce qui fait une vie. Essai sur la violence, la guerre et le deuil, trad. de Joëlle Marelli, Paris, Zones, 2010)).
C’est à partir de la douleur que chaque femme possède en propre, qu’avec des tissus, de la laine et des aiguilles, elle se représente dans l’image telle qu’elle a voulu se montrer, dans un geste catégorique d’auto-affirmation. Elle (s’auto)-représente avec toutes les implications du terme, au sens esthétique et aussi politique : elle parle d’elle-même en son nom et par ce geste, elle parle pour celui qui n’est plus là. Aujourd’hui, il m’est possible de m’approcher de ces visages cousus, schématiques et maladroits car cette douleur vient du for intérieur et sort vers l’extérieur. Derrière les traits graves, contenus et sereins de ces figures, c’est une femme qui nous observe – les yeux de l’image.
Cependant, face à la photo d’Eduardo Gil, c’est moi qui interroge en tant qu’étrangère les traits également graves, contenus et sereins de chacune d’elles. Le rapprochement recherché par le photographe ne parvient pas à nous situer de l’autre côté. Un voile s’interpose entre nous et ces femmes, symbolisé par la banderole obscure qu’elles tiennent agrippée et qui se déploie comme un mur infranchissable.
Prise d’un point de vue extérieur, la photographie de Gil s’arrête devant et capture le moment.
4.Des silhouettes qui se découpent dans l’arpillera.
Des silhouettes uniformes et inconnues situées au fond de l’image, des silhouettes penchées aux fenêtres, des silhouettes qui soulèvent des pancartes et des silhouettes sur les pancartes elles-mêmes. Des silhouettes qui, toutes, rendent présente une absence, comme la photographie. L’œuvre entière est pénétrée de cette présence spectrale, où la frontière entre la vie et la mort est restée suspendue. Les femmes sont aussi des ombres attrapées dans un deuil qui ne peut s’accomplir.
Quelques mois après la deuxième Marche de la résistance, le 21 septembre 1983, Eduardo Gil s’implique activement dans ce qu’on a appelé le Siluetazo : trente-mille silhouettes de figures humaines, dessinées à l’échelle 1 sur du papier, occupèrent les rues de Buenos Aires, donnant une présence aux corps des trente-mille disparus. Ce qui fournit à Gil l’occasion d’engager un dialogue étroit entre son appareil photo et les silhouettes, soulignant que celles-ci, comme la photographie, sont le contour diffus de ce qui, un jour, exista.
Empreintes fantomatiques, leur nature est liée à la mort, à la disparition du corps vivant et du temps.
La distance naturelle entre le portrait du parent et le corps qui le soutient est réduite sur la photo, comme sur l’arpillera, à un seul et même plan de réalité. Les uns et les autres, disparus et présents, se fondent et se confondent par effet de la représentation, en un bal de silhouettes.
La volonté systématisée d’étouffer l’unicité et la singularité du sujet par la répétition et l’anonymat de la violence est contrecarrée par le fait de rendre un nom et une forme à chaque corps – une ombre en papier sur les murs –, ou en rappelant la mémoire d’un visage unique – exposé sur des pancartes et collé sur la poitrine.
Des instruments actifs de protestation publique pour des pays peuplés de vides.
5.L’arpillera est anonyme. Aucun sujet ne s’affirme en tant que tel derrière l’image, il s’agit plutôt du résultat d’expériences partagées, de complicités, de solidarités ; d’échanges qui surgissent alors que l’on coud, que l’on parle, ou que l’on se tait. C’est un témoignage à plusieurs voix, où chacune s’exprime avec la particularité de son timbre. De même, les femmes qui avancent avec les bras levés sont un chœur où toutes défilent en groupe, et où l’on peut cependant ressentir la douleur de chacune d’elles.
Alors quel’on connaît la date et le lieu de la marche photographiée par Eduardo Gil, il est impossible de savoir quand et où marchent les femmes de tissu. La photographie se joue dans la tension entre la fugacité de l’instant et son enregistrement pour une postérité, entre l’instant et son empreinte ((N. RICHARD “Imagen-recuerdo y borraduras” dans Políticas y estéticas de la memoria, Santiago de Chile, Cuarto Propio, 2000, p. 165)), tandis que l’arpillera s’ouvre sur un temps dilaté, où l’on coud et l’on découd, où l’on discute, où l’on pleure, où l’on rit parfois, où l’on attend et l’on continue à chercher.
Marina Vinyes Albes
Traduction de l’espagnol par Antoine Leonetti
L’auteure adresse tous ses remerciements à Victoria Diaz, arpillerista, auteure anonyme de Marcha de mujeres de familiares de detenidos desaparecidos [Marche des femmes pour les détenus disparus] et au Museo de la Memoria y los Derechos Humanos, pour son accueil et son immense travail d’archivage.
Marina Vinyes Albes est chercheuse et enseignante à l’Université Paris-Sorbonne, où elle prépare – en cotutelle avec l’Université de Barcelone – une thèse sur les liens entre identité, représentation et mémoire en relation avec les arpilleras politiques chiliennes. En 2015 et pour le Jeu de Paume, elle a été responsable du commissariat de l’exposition “Omer Fast. Le présent continue”, et elle a publié le livre intitulé Usos i abusos de la imatge en l’univers visual de la Shoah [Usages et abus de l’image dans l’univers visuel de la Shoah]. Commissaire indépendante de programmations cinématographiques, elle collabore avec le supplément Cultura/s de La Vanguardia, et le magazine du Jeu de Paume.
| 1↑ | On considère que l’origine des arpilleras est liée à l’artisanat des femmes de pêcheurs d’Isla Negra, ainsi qu’aux premières tapisseries de Violeta Parra, dans les années 1960. Cependant, tout en possédant cette origine artistique et artisanale, les arpilleras conçues sous la dictature répondent à une cause, une intentionnalité et un système de production différents, en tant qu’expression démocratique féminine de la résistance, de la solidarité et du maintien de la structure familiale détruite par le régime militaire. Nés sous l’aile du Comité pour la paix (Comité ProPaz) – qui deviendra plus tard le Vicariat de la solidarité –, les ateliers du Regroupement de parents de détenus disparus ont donné lieu un peu plus tard à d’autres ateliers composés de femmes d’origine modeste des bidonvilles de Santiago. Ils reçoivent le soutien d’autres organisations comme la fondation Missio, la FASIC (Fondation d’aide sociale des églises chrétiennes) ou la PIDEE (Fondation de protection de l’enfance touchée par les états d’urgence). |
| 2↑ | Le mot arpillera signifie à la base toile de jute (N.D.T.). |
| 3↑ | Cf. La Segunda, 16 avril 1980 ; La Segunda, 26 juillet 1978; El Mercurio, 13-19 août 1978 |
| 4↑ | Georges Didi-Huberman : “Le message des papillons”, publié à l’origine dans P. Turlais : Tracts et papillons de la résistance, Paris, éditions Artulis, 2016. Disponible sur le site web : http://resistance.editionsartulis.fr/ |
| 5↑ | Cf.Georges Didi-Huberman : Quand les images prennent position. L’œil de l’histoire, 1, Paris, éditions de Minuit, coll. “Paradoxe”, 2009 |
| 6↑ | Cf. J. Butler : Ce qui fait une vie. Essai sur la violence, la guerre et le deuil, trad. de Joëlle Marelli, Paris, Zones, 2010 |
| 7↑ | N. RICHARD “Imagen-recuerdo y borraduras” dans Políticas y estéticas de la memoria, Santiago de Chile, Cuarto Propio, 2000, p. 165 |