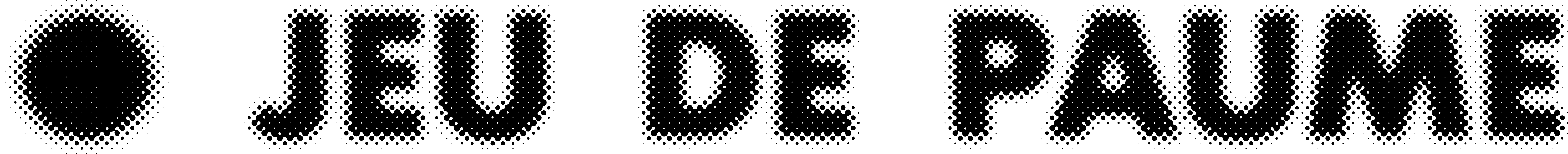Guide d'exposition
Textes de salles
Luc Delahaye. Le bruit du monde
Luc Delahaye est né à Tours en 1962. En 1984, après quelques années d’errance et d’emplois divers, il s’installe à Paris où il fait ses premiers reportages, part en Angleterre photographier la grève des mineurs et rejoint la petite agence Moba Presse. Il y couvre au quotidien l’actualité politique et sociale, le show-business et les faits divers. En 1985, grâce à une série paparazzi, il est engagé à l’agence Sipa Press et envoyé à Beyrouth, où il fait sa première expérience de la guerre. Suivront de nombreux reportages de guerre et d’actualité internationale en Afghanistan, en Bosnie, au Rwanda, en Tchétchénie, en Irak, en Cisjordanie et à Gaza, en Haïti, au Congo, au Soudan, en Somalie, etc. Il rejoint Magnum Photos en 1994 et signe la même année un contrat avec le magazine Newsweek. Il est élu membre de Magnum en 1998 et restera dans cette agence jusqu’à son départ, en 2004. Ses reportages sont salués par le prix Robert Capa (1993, 2002), des premiers prix du World Press Photo (1992, 1993, 2002), le prix Paris Match (1992, 1994), le Visa d’or (1993) et le prix Bayeux des correspondants de guerre (2002). Pendant ces années, parallèlement à son activité de photojournaliste, il réalise plusieurs travaux documentaires, dont certains sont publiés sous forme de livres et récompensés par le prix Oskar-Barnack (2000), l’ICP Infinity Award (2001) et le prix Niépce (2002).
En 2001, il cesse de travailler pour la presse et commence la réalisation de ses tableaux photographiques. Ces premiers travaux sont présentés en 2003 à la galerie Ricco / Maresca à New York, année où il publie History (Chris Boot), puis à la Maison rouge à Paris en 2005 et au J. Paul Getty Museum à Los Angeles en 2007. Il est lauréat du prix Deutsche Börse en 2005 et du prix Pictet en 2012.
En 2001, après quinze années de photoreportage de guerre et alors qu’il a acquis un statut très en vue dans sa profession, Delahaye choisit de délaisser le format traditionnel du reporter et de la page de magazine pour explorer une forme, celle du tableau photographique. Cette décision se traduit par la mise en place d’une nouvelle manière de faire des images et par l’adoption d’un nouvel appareil, de format panoramique. Le choix confère à l’ensemble de la vingtaine d’images qu’il réalise alors, sur une période de quatre ans, une identité radicalement distincte de son travail de photojournaliste : la grandeur des tirages en fait des images destinées à être regardées au mur par un spectateur-lecteur — un mode de lecture qui est encore aujourd’hui celui de ses images.
« Je me suis rendu compte plus tard de l’utilité qu’avait eu ce moment panoramique : la prise de distance à laquelle ce format invite m’a permis de “calibrer” mes distances. Il y a la distance minimum, celle du reporter, que je connaissais bien, il y a la distance maximum, au-delà de laquelle les figures disparaissent, et cela forme l’espace mesurable des distances communes à tous. Et puis il y a la distance mentale du photographe et son point de présence réelle. Le panoramique m’a aidé à clarifier cette question. Mais je dois dire que ce mot, panoramique, qu’on accolait à mes images, m’a longtemps agacé : comme si le format en était la clé. J’essayais de faire des tableaux, ce qui est quand même une autre affaire… » Le format panoramique permet un élargissement de la vision et favorise une prise de distance à l’égard du réel, inhérente au panorama. La juste distance n’est plus celle du photoreportage classique où, souvent, plus proche est le photographe de son sujet, meilleure est la photographie. Elle est celle d’un retrait, parfois couplé à un léger surplomb. Les images sont marquées par une volonté d’effacement, de neutralité, un retrait expressif qui est une constante dans le travail de Delahaye. L’opérateur semble s’être absenté. Les individus, bien que présents et face à nous, nous ignorent, absorbés dans leur propre monde ou trop à distance pour remarquer le photographe.
Luc Delahaye a toujours refusé l’idée « d’avoir un sujet » : suivre l’actualité est pour lui la meilleure façon d’esquiver la question. Le déclencheur est souvent une image qui se forme à la lecture de la presse et l’engage à se rendre sur place. Suivant un processus qui s’efforce de ne pas être trop réfléchi ni trop documenté, ni trop rationnel, mais demeure de l’ordre de l’intuition et laisse une place à l’imaginaire. Dans ces années-là, le désordre des situations de guerre retient autant son attention que la pompe des commémorations et des grandes instances internationales, la violence des unes semblant répondre à l’ordonnancement des autres. Si l’actualité qui le guide est le plus souvent liée à des situations extrêmes, c’est que ces dernières, en tant que perturbations dramatiques du réel, génèrent à ses yeux des états de dérèglement qui se prêtent à l’enregistrement photographique : la réalité se donne autrement, de manière brutale et inattendue, elle offre une prise. Elle est parfois difficile à regarder mais il faut quand même tenter de la restituer, sans pathos et avec une forme d’absence, meilleure garante, à ses yeux, d’une justesse documentaire.
À partir de 2004-2005, Luc Delahaye cherche à donner une présence physique plus grande aux individus représentés, à leur vocabulaire corporel, à leurs gestes comme à leurs expressions, dans une relation désormais presque égalitaire avec le spectateur, afin de faire de la figure humaine la composante essentielle de son travail. Face à ces exigences nouvelles, le photographe est amené peu à peu à modifier sa méthode de travail : dès 132nd Ordinary Meeting of the Conference, exposée ici, il adopte la technique de la composition par ordinateur à partir de plusieurs clichés réalisés dans cette intention. Dans le même temps, il opère une amplification des formats. Ses images précédentes s’inscrivaient encore dans une conception de la photographie largement partagée par les photoreporters au xxe siècle : celle d’une centralité de la prise de vue, envisagée, dans sa relation directe à l’instant, comme le moment essentiel de la production de l’image. L’image composée transgresse cette règle. Luc Delahaye, pourtant, insiste sur les éléments de continuité : « Mes photos “construites” reposent toujours sur le reportage. Elles sont constituées de fragments de réel, de moments d’expérience, qui ont pour moi la valeur de documents photographiques ». Dans un cas comme dans l’autre, il s’agit d’essayer de rendre compte d’une vérité de l’instant, mais celle-ci est parfois différente de l’exactitude transmise par la prise de vue unique.
Pendant des années, Delahaye a découpé dans les journaux les photographies d’actualité qui retenaient son attention, comme autant de documents de travail destinés à nourrir une réflexion et, éventuellement, à susciter un départ. À partir de 2006, cette pratique a progressivement dévié de son but initial pour prendre une existence autonome. Cette accumulation proliférante et sans fin contenait la forme d’une certaine vision du monde, assez sombre, qui repose autant sur l’expérience du spectateur de l’actualité de son temps que sur celle du photographe. Ce n’est qu’en 2020 qu’il donnera à ce matériau son expression actuelle : reproductions, en noir et blanc, de détails agrandis, dans un format unique et sans commentaire ni légende. Une démarche nouvelle, puisque le matériau de départ est constitué d’images réalisées par d’autres, échappant donc aux enjeux de présence et d’expérience du réel qui sont au coeur de sa pratique.
Les deux corpus d’oeuvres regroupés dans cette salle, l’un réalisé en Haïti et l’autre en Cisjordanie, témoignent de la diversité des approches de Luc Delahaye depuis une quinzaine d’années. Les images prises en Haïti en 2010 s’apparentent, malgré leurs dimensions, à l’approche classique, instantanée, du photoreportage : des scènes de chaos, saisies sur une période brève, dans les jours qui ont suivi le tremblement de terre, au hasard de ses déplacements dans les rues de Port-au-Prince, et conçues indépendamment les unes des autres. Celles réalisées en Cisjordanie entre 2015 et 2017, au cours de six séjours, ont été élaborées comme un ensemble et réunies sous le titre Sūmud — « fermeté », « détermination », « persévérance », en arabe — qui désigne une stratégie de résistance à l’occupation. La plupart sont des mises en scène, reconstitutions de situations vues ou inventions, dont les participants sont des personnes rencontrées sur place. Avec des photographies comme Taxi, Récolte et Sumud, témoignant de son attachement à la Palestine, Luc Delahaye déplace, de manière presque allégorique la question du conflit israélo-palestinien vers un territoire à la fois poétique et concret, ancré dans le quotidien le plus ordinaire, très éloigné des représentations habituelles.
« Les photos mises en scène […] naissent soit d’une rencontre, soit d’une chose vue, et la dimension d’expérience en est toujours le socle, bien que de façon nécessairement différée. C’est une histoire, parallèle à l’histoire “officielle” de l’image, faite du mouvement des relations humaines et qui viendra s’inscrire au revers de l’image. Le moment des prises de vue dans ces mises en scène est un moment de tension intérieure qui, pour moi, est exactement équivalent à la prise de vue en reportage. Ce n’est pas le personnage d’une fiction que je photographie mais la réalité extérieure d’une personne, par fragments, méthodiquement, patiemment, et ardemment. Je documente. Mes images mises en scène sont vraiment très simples, réalisées avec des moyens modestes, mais il leur faut cela pour qu’à mes yeux elles aient une existence légitime. »
« Ce registre de l’innommable n’était pas caché, réservé à quelques-uns, il était au contraire accessible à tous sur Internet. J’ai regardé ces vidéos de Syrie tous les jours pendant plus d’un an, instaurant un rituel, chaque matin regardant les images de la veille. Pour la première fois je crois, on pouvait tout voir d’une guerre, les centaines de vidéos quotidiennes en offraient une vue panoramique et affreusement détaillée, et il était fascinant de voir cette documentation à grande échelle, cette fresque proliférante générée par une multitude d’actes individuels, se constituer en archives de l’histoire immédiate. Les citoyens ordinaires qui en étaient les auteurs entendaient porter au monde la réalité des crimes commis par le régime dans ce qui n’était pas une guerre civile mais une “guerre faite aux civils”*. C’étaient des images tremblantes, maladroites et directes. Leur force ne venait pas de ce qu’elles étaient cruelles, mais de leur évidence : elles ne procédaient que de la seule nécessité de témoigner, et de ce que cette nécessité contenait d’impuissance, quand il ne reste plus rien d’autre à faire que cela, des images. » Les centaines de photogrammes extraits de ces vidéos constituent Rapport Syrie, longue séquence silencieuse déroulant impassiblement la matière pixelisée, mais souvent irregardable, de ces images. * Selon l’expression de Catherine Coquio (À quoi bon encore le monde ? La Syrie et nous, 2022)
Conçues à la même période autour de sujets très différents (la salle des marchés de la Bourse aux métaux de Londres, l’armée régulière syrienne dans les rues d’Alep), les deux grandes compositions Trading Floor et Soldats de l’Armée syrienne, Alep, novembre 2012, appartiennent à un même genre ou registre allégorique. Par la stylisation des gestes, la chorégraphie inédite des postures et l’exagération parfois caricaturale des expressions, ce sont les moins réalistes de toutes les images de son répertoire, dans lequel elles introduisent par ailleurs une nouvelle tonalité, grotesque ou irréelle. Se permettant un pas de côté avec l’ancrage documentaire, Delahaye a utilisé des portraits de traders photographiés à Londres — et dont il fait par ailleurs une oeuvre spécifique, Trading Floor (Études) — pour composer les visages de certains de ses soldats syriens, dressant un lien indirect entre ces deux « scènes de bataille » contemporaines.
« La ville était déserte, les forces gouvernementales s’étaient enfuies. Par petits groupes, pour s’assurer la place, les rebelles se répandaient dans les rues silencieuses, entraient dans chaque maison. C’est dans ces circonstances que j’ai fait cette photo. À l’ordinateur, j’ai modifié la couleur du tee-shirt. Il était orange passé, comme les murs de la maison, et il est devenu ce violet profond. J’ai fait disparaître un élément, une sorte d’étagère fixée au mur. Et j’ai corrigé les déformations dues à l’optique, qui sont apparentes quand on photographie une architecture. Il faut débarrasser l’image de ces scories qui la qualifient comme photo de la manière la plus ingrate, qui “laissent parler” les insuffisances de la technique. Et pour cela s’appuyer sur une convention de représentation, géométrique, qui bien sûr ne correspond pas plus à la réalité de notre vision mais a le mérite, en tant que convention, d’être tacitement acceptée. La distorsion photographique est un empêchement visuel, il me semblait impossible que le milicien puisse passer le seuil d’une telle maison. Il entre, donc, et dans un instant on ne le verra plus. House to House est étroitement liée à la photo faite quelques minutes après, dans la cour d’une autre maison : Death of a Mercenary est son envers. Extérieur, intérieur. Si la première est une métaphore de la disparition ou de l’absence — peut-être aussi, mais cela ne regarde que moi, une métaphore de ma position de photographe et de mes absences calculées —, la seconde est une image d’apparition. À l’effacement en cours du milicien s’oppose la présence frontale et douloureuse du mercenaire, l’évidence, la réalité concrète d’un visage à l’instant de la mort. »
Depuis une dizaine d’années, le noir et blanc a fait son retour dans l’oeuvre de Luc Delahaye : non retouchées, de petites dimensions, présentées le plus souvent au mur en ensembles ordonnés, ses images en noir et blanc renvoient à un langage photographique sériel ou typologique, cher à l’esthétique documentaire. Néanmoins, l’ordinateur demeure le véritable laboratoire de développement de l’image : c’est devant l’écran que désormais s’effectue la majorité de son travail. Sa pratique s’apparente davantage à celle d’une écriture, d’une écriture par l’image, pour parvenir à réaliser une image qui « pense ». Une image qui ne soit ni liée à l’intention initiale de son auteur, ni trop étroitement dépendante du réel. Luc Delahaye semble aujourd’hui bien loin de l’imaginaire héroïque du photographe de guerre, même si cette dernière demeure pour lui un sujet privilégié, comme le confirme sa présence en 2022 en Ukraine dans les premiers mois du conflit. Il y réalise, entre exactions et exécutions sommaires, certaines de ses images les plus perturbantes autour du regard porté sur la violence : celui des exécuteurs, celui du photographe, le nôtre.