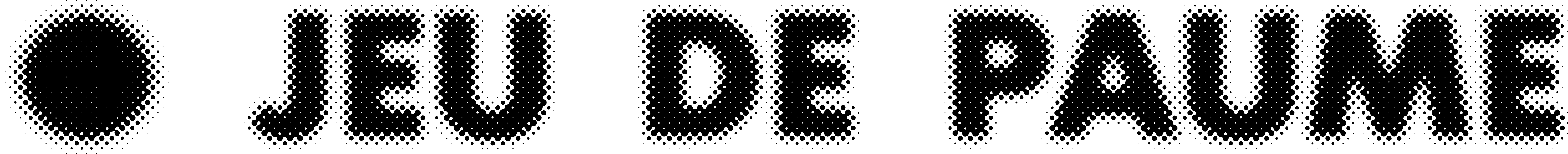Archive magazine (2009 – 2021)
Zineb Sedira
Parcours commenté dans l'exposition
Ève Lepaon et Cécile Tourneur, conférencières et formatrices au Jeu de Paume, proposent un aperçu du parcours commenté qu’elles réalisent dans l’exposition de Zineb Sedira, « L’espace d’un instant » au Jeu de Paume.
Dans les salles, l’artiste déjoue d’une certaine manière la condition ambigüe d’« œuvre d’art »1 en déroulant d’un geste fluide des objets, des images, des archives, des installations et en jouant des porosités entre les pièces… C’est peut-être ce même mouvement très libre et personnel qui lui permet de parler aussi bien des frontières géographiques et politiques que de la (re)transmission d’histoires individuelles à travers les époques.

Des photographies de bateaux en noir et blanc sont posées sur une table et filmées en plan serré. Les images passent d’un écran à l’autre. Les mains et la voix de Zineb Sedira, énumérant leurs noms, rythment leur défilement. L’artiste, née à Paris en 1963 de parents algériens exilés en France au début des années 1960, s’installe à Londres en 1986. Réalisée en 2012, l’œuvre Transmettre en abyme se compose de deux parties : ce diptyque vidéo et un entretien avec Hélène Detaille, conservatrice du fonds du photographe marseillais Yvon Colas, surnommé Marcel Baudelaire. Zineb Sedira s’intéresse à l’exceptionnel ensemble photographique qu’il a constitué en marge de sa pratique professionnelle entre les années 1930 et 1980. Chaque jour il se rendait sur le port, prenait des photos des navires suivant un protocole de prise de vue très strict et documentait chaque image de manière précise (date, heure, provenance, nom). Si cette collection témoigne au départ d’une obsession personnelle, elle constitue aussi une archive précieuse des échanges commerciaux, touristiques et migratoires que Marseille a entretenu avec le monde pendant ces années-là. Entre mémoire personnelle et mémoire collective, Zineb Sedira met en lumière la nécessité de recueillir, conserver et transmettre les témoignages et les archives. Cette installation vidéo est une mise en abyme de son travail d’artiste : elle s’interroge aussi sur le devenir de ses propres photographies, films et collections. Cette œuvre, mêlant démarche documentaire et approche poétique, met en avant le rôle des images et des récits dans la construction de l’histoire. L’épaisseur de la pile de photographies et la superposition des voix semblent évoquer la sédimentation à l’œuvre dans le processus de mémoire.
Ève Lepaon
Des photographies de bateaux en noir et blanc sont posées sur une table et filmées en plan serré. Les images passent d’un écran à l’autre. Les mains et la voix de Zineb Sedira, énumérant leurs noms, rythment leur défilement. L’artiste, née à Paris en 1963 de parents algériens exilés en France au début des années 1960, s’installe à Londres en 1986. Réalisée en 2012, l’œuvre Transmettre en abyme se compose de deux parties : ce diptyque vidéo et un entretien avec Hélène Detaille, conservatrice du fonds du photographe marseillais Yvon Colas, surnommé Marcel Baudelaire. Zineb Sedira s’intéresse à l’exceptionnel ensemble photographique qu’il a constitué en marge de sa pratique professionnelle entre les années 1930 et 1980. Chaque jour il se rendait sur le port, prenait des photos des navires suivant un protocole de prise de vue très strict et documentait chaque image de manière précise (date, heure, provenance, nom). Si cette collection témoigne au départ d’une obsession personnelle, elle constitue aussi une archive précieuse des échanges commerciaux, touristiques et migratoires que Marseille a entretenu avec le monde pendant ces années-là. Entre mémoire personnelle et mémoire collective, Zineb Sedira met en lumière la nécessité de recueillir, conserver et transmettre les témoignages et les archives. Cette installation vidéo est une mise en abyme de son travail d’artiste : elle s’interroge aussi sur le devenir de ses propres photographies, films et collections. Cette œuvre, mêlant démarche documentaire et approche poétique, met en avant le rôle des images et des récits dans la construction de l’histoire. L’épaisseur de la pile de photographies et la superposition des voix semblent évoquer la sédimentation à l’œuvre dans le processus de mémoire.
Ève Lepaon

Après le port de Marseille, nous traversons la Méditerranée pour rejoindre la côte algérienne : le Cap Sigli en petite Kabylie et le Cap Caxine à proximité d’Alger. Zineb Sedira ne se confronte pas directement à l’héritage familial dans l’installation Lighthouse in the Sea of Time, mais choisit de questionner la généalogie et la transmission d’un métier, en s’intéressant à l’histoire de deux phares et au gardien de l’un d’entre eux. La remontée du temps s’effectue par cet escalier en spirale, que Zineb Sedira gravit en comptant le nombre de marches qui la sépare du sommet du phare du Cap Caxine. Elle y découvre un musée, qui contient des objets de l’époque coloniale, ces phares ayant été construits par les Français au milieu du XIXe et au début du XXe siècles. En feuilletant les registres, nous passons de l’occupation française au début des combats pour l’indépendance au milieu des années 1950. En 1962, les noms des visiteurs de ces lieux, autrefois majoritairement français, laissent place à des noms algériens, indiquant la victoire. Krimo, gardien de phare au Cap Sigli, fait partie des héritiers de ce métier interdit aux Algériens avant l’indépendance. Il apparaît dans les deux autres parties qui constituent Lighthouse in the Sea of Time, où nous le voyons exécuter manuellement tous les gestes qui composent son activité, de l’entretien de la tour à la tenue des comptes-rendus journaliers [...]
Après le port de Marseille, nous traversons la Méditerranée pour rejoindre la côte algérienne : le Cap Sigli en petite Kabylie et le Cap Caxine à proximité d’Alger. Zineb Sedira ne se confronte pas directement à l’héritage familial dans l’installation Lighthouse in the Sea of Time, mais choisit de questionner la généalogie et la transmission d’un métier, en s’intéressant à l’histoire de deux phares et au gardien de l’un d’entre eux. La remontée du temps s’effectue par cet escalier en spirale, que Zineb Sedira gravit en comptant le nombre de marches qui la sépare du sommet du phare du Cap Caxine. Elle y découvre un musée, qui contient des objets de l’époque coloniale, ces phares ayant été construits par les Français au milieu du XIXe et au début du XXe siècles. En feuilletant les registres, nous passons de l’occupation française au début des combats pour l’indépendance au milieu des années 1950. En 1962, les noms des visiteurs de ces lieux, autrefois majoritairement français, laissent place à des noms algériens, indiquant la victoire. Krimo, gardien de phare au Cap Sigli, fait partie des héritiers de ce métier interdit aux Algériens avant l’indépendance. Il apparaît dans les deux autres parties qui constituent Lighthouse in the Sea of Time, où nous le voyons exécuter manuellement tous les gestes qui composent son activité, de l’entretien de la tour à la tenue des comptes-rendus journaliers […]

[...] Une installation composée de quatre écrans, permet de multiplier les points de vue sur les lieux : nous sommes simultanément à l’intérieur des bâtiments, d’où nous observons les remous de la mer, et sur la jetée au pied des tours. À l’image de la lentille brisée, la fragmentation permet de mettre en lumière et de reconstituer en creux la réappropriation du territoire et des côtes par les Algériens après l’indépendance. Aujourd’hui, le film se charge encore d’une autre valeur : le témoignage de Krimo constitue une archive de ce métier, devenu peu à peu automatisé et voué à disparaître.
Cécile Tourneur
[…] Une installation composée de quatre écrans, permet de multiplier les points de vue sur les lieux : nous sommes simultanément à l’intérieur des bâtiments, d’où nous observons les remous de la mer, et sur la jetée au pied des tours. À l’image de la lentille brisée, la fragmentation permet de mettre en lumière et de reconstituer en creux la réappropriation du territoire et des côtes par les Algériens après l’indépendance. Aujourd’hui, le film se charge encore d’une autre valeur : le témoignage de Krimo constitue une archive de ce métier, devenu peu à peu automatisé et voué à disparaître.
Cécile Tourneur

L’installation intitulée Standing Here Wondering Which Way to Go réunit plusieurs œuvres de Zineb Sedira. Ce morceau de pellicule provient du film de William Klein, Le Festival panafricain d’Alger 1969. Tourné au moment de cet événement culturel et politique d’une ampleur inédite, le film constitue un document unique qui a beaucoup influencé Zineb Sedira. Coordonné par l’Organisation de l’Unité Africaine et financé en grande partie par l’État algérien, le festival rassemble différents mouvements de libération provenant de toute l’Afrique, mais aussi d’Amérique latine et des États-Unis, notamment les Black Panthers, venus clamer leur volonté d’émancipation à Alger, devenue depuis 1962 « la Mecque des révolutionnaires ». Les organisateurs, comme le président de la République algérienne Houari Boumédiène, en sont convaincus : face à l’uniformisation induite par la colonisation et l’impérialisme, seule l’affirmation des cultures et de la diversité pourra constituer le fondement des révolutions à venir. Les délégations de chaque pays ou mouvement présentent des expositions, représentations théâtrales et performances de rue, mêlant danse, chants et musique. Le film restitue toute l’énergie et la frénésie de cet instant. Avec le titre We Have Come Back, Archie Shepp, figure afro-américaine du free jazz, accompagné pour l’occasion de musiciens algériens, puise dans les racines de la musique pour mieux traduire son combat culturel et politique. La militante sud-africaine Miriam Makeba, qui a joué dans le film de Lionel Rogosin Come Back Africa en 1959, chante contre l’Apartheid et pour les droits civiques aux États-Unis. Déchue de sa nationalité sud-africaine, elle se réfugie en Algérie, qui lui offre l’asile. Les infimes mouvements de son visage filmés par William Klein tout comme l’image de la bande-son courant sur le côté gauche de la pellicule et observés ici sous la loupe de Zineb Sedira, apparaissent encore aujourd’hui tels les soubresauts des révolutions des années 1960.
[E.L.]
L’installation intitulée Standing Here Wondering Which Way to Go réunit plusieurs œuvres de Zineb Sedira. Ce morceau de pellicule provient du film de William Klein, Le Festival panafricain d’Alger 1969. Tourné au moment de cet événement culturel et politique d’une ampleur inédite, le film constitue un document unique qui a beaucoup influencé Zineb Sedira. Coordonné par l’Organisation de l’Unité Africaine et financé en grande partie par l’État algérien, le festival rassemble différents mouvements de libération provenant de toute l’Afrique, mais aussi d’Amérique latine et des États-Unis, notamment les Black Panthers, venus clamer leur volonté d’émancipation à Alger, devenue depuis 1962 « la Mecque des révolutionnaires ». Les organisateurs, comme le président de la République algérienne Houari Boumédiène, en sont convaincus : face à l’uniformisation induite par la colonisation et l’impérialisme, seule l’affirmation des cultures et de la diversité pourra constituer le fondement des révolutions à venir. Les délégations de chaque pays ou mouvement présentent des expositions, représentations théâtrales et performances de rue, mêlant danse, chants et musique. Le film restitue toute l’énergie et la frénésie de cet instant. Avec le titre We Have Come Back, Archie Shepp, figure afro-américaine du free jazz, accompagné pour l’occasion de musiciens algériens, puise dans les racines de la musique pour mieux traduire son combat culturel et politique. La militante sud-africaine Miriam Makeba, qui a joué dans le film de Lionel Rogosin Come Back Africa en 1959, chante contre l’Apartheid et pour les droits civiques aux États-Unis. Déchue de sa nationalité sud-africaine, elle se réfugie en Algérie, qui lui offre l’asile. Les infimes mouvements de son visage filmés par William Klein tout comme l’image de la bande-son courant sur le côté gauche de la pellicule et observés ici sous la loupe de Zineb Sedira, apparaissent encore aujourd’hui tels les soubresauts des révolutions des années 1960.
[E.L.]

Si le film Le Festival panafricain d’Alger 1969 est signé du nom du photographe et cinéaste américain William Klein, des dizaines d’opérateurs images et son ont déambulé dans les rues d’Alger avec un matériel portable, léger, témoignant des récents progrès techniques du cinéma documentaire. Coordonnant le tournage des différents événements du festival à toute heure du jour et de la nuit, William Klein s’est entouré de personnalités du cinéma pour la plupart engagés dans des films militants. Du côté français, nous retrouvons les noms de Pierre Lhomme, Bruno Muel et Yann Le Masson et la monteuse Jacqueline Meppiel. Aidés par leur homologue québécois et grande figure du cinéma direct Michel Brault, venu porter main forte aux équipes sur place, les cinéastes et opérateurs algériens (entre autres, Slimane Riad, Ahmed Lallem, Mohamed Bouamari) ont pu apporter leur point de vue sur ce rassemblement, le deuxième plus important depuis la déclaration de l’Indépendance. La collaboration de Klein avec l’état algérien pendant le festival panafricain sera double puisqu’il bénéficie du soutien du ministère algérien de l’information pour tourner un documentaire sur Eldridge Cleaver, également présent à Alger aux côtés des Black Panthers. La réalisation de ces films s’inscrit également dans l’effervescence des premières années de la Cinémathèque d’Alger, créée en 1965 sous l’impulsion de Jean-Michel Arnold, proche d’Henri Langlois, qui fait émerger l’idée d’un lieu de conservation et de mémoire pour le cinéma en Algérie. Très vite, la Cinémathèque d’Alger accueille des cinéastes du monde entier, et des rétrospectives ambitieuses : William Klein viendra présenter son désormais culte Qui êtes-vous Polly Maggoo ? (1967) et l’insolent et anti-impérialiste Mister Freedom (1968).
[C.T.]
Si le film Le Festival panafricain d’Alger 1969 est signé du nom du photographe et cinéaste américain William Klein, des dizaines d’opérateurs images et son ont déambulé dans les rues d’Alger avec un matériel portable, léger, témoignant des récents progrès techniques du cinéma documentaire. Coordonnant le tournage des différents événements du festival à toute heure du jour et de la nuit, William Klein s’est entouré de personnalités du cinéma pour la plupart engagés dans des films militants. Du côté français, nous retrouvons les noms de Pierre Lhomme, Bruno Muel et Yann Le Masson et la monteuse Jacqueline Meppiel. Aidés par leur homologue québécois et grande figure du cinéma direct Michel Brault, venu porter main forte aux équipes sur place, les cinéastes et opérateurs algériens (entre autres, Slimane Riad, Ahmed Lallem, Mohamed Bouamari) ont pu apporter leur point de vue sur ce rassemblement, le deuxième plus important depuis la déclaration de l’Indépendance. La collaboration de Klein avec l’état algérien pendant le festival panafricain sera double puisqu’il bénéficie du soutien du ministère algérien de l’information pour tourner un documentaire sur Eldridge Cleaver, également présent à Alger aux côtés des Black Panthers. La réalisation de ces films s’inscrit également dans l’effervescence des premières années de la Cinémathèque d’Alger, créée en 1965 sous l’impulsion de Jean-Michel Arnold, proche d’Henri Langlois, qui fait émerger l’idée d’un lieu de conservation et de mémoire pour le cinéma en Algérie. Très vite, la Cinémathèque d’Alger accueille des cinéastes du monde entier, et des rétrospectives ambitieuses : William Klein viendra présenter son désormais culte Qui êtes-vous Polly Maggoo ? (1967) et l’insolent et anti-impérialiste Mister Freedom (1968).
[C.T.]

Dès la fin des années 1950, René Vautier, cinéaste engagé aux côtés du FLN pendant la guerre d’indépendance, initie les combattants algériens à la production de leurs propres images, pour raconter leur combat, constituer des archives et transmettre leur histoire. Après l’indépendance, il crée et dirige le Centre audiovisuel d’Alger qui donne naissance au film Le Peuple en marche (1963), considéré comme le premier film militant algérien, début d’une effervescence créative qui va fortement se développer au cours des années 1960 et 1970 et jusqu’à la « décennie noire ». L’œuvre de Zineb Sedira intitulée Scene 1: mise-en-scène et faisant partie de l’installation Standing Here Wondering Which Way to Go, revient sur cette appropriation des moyens d’expressions cinématographiques pour témoigner des actions militantes. Zineb Sedira a trouvé dans une brocante à Alger des morceaux de pellicule réunis dans une boîte en métal. En les visionnant, elle découvre différentes scènes plus ou moins lisibles selon le degré de dégradation du support celluloïd. Certains visages et actions nous apparaissent clairement, tandis que d’autres semblent se dissoudre en même temps que les émulsions attaquent la pellicule. Zineb Sedira pose alors la question de la survie de ces images et de leur persistance dans le temps. Elle indique ainsi la nécessité d’une conservation préventive pour éviter qu’une part de l’histoire ne s’évanouisse avec elles, renvoyant également à l’importance des cinémathèques dans cette fonction. La numérisation laisse apparaître de chaque côté de l’image les perforations des bobines 16mm et 35mm, de même que la colorisation intégrale de la pellicule noir et blanc en une teinte unique, racontant une histoire des techniques filmiques utilisées. La pellicule rayée peut aussi évoquer la pratique de certains cinéastes expérimentaux des années 1960, notamment Stan Brakhage, qui en grattant les photogrammes de ses films, faisait émerger la matérialité des images cinématographiques.
[C.T.]
Dès la fin des années 1950, René Vautier, cinéaste engagé aux côtés du FLN pendant la guerre d’indépendance, initie les combattants algériens à la production de leurs propres images, pour raconter leur combat, constituer des archives et transmettre leur histoire. Après l’indépendance, il crée et dirige le Centre audiovisuel d’Alger qui donne naissance au film Le Peuple en marche (1963), considéré comme le premier film militant algérien, début d’une effervescence créative qui va fortement se développer au cours des années 1960 et 1970 et jusqu’à la « décennie noire ». L’œuvre de Zineb Sedira intitulée Scene 1: mise-en-scène et faisant partie de l’installation Standing Here Wondering Which Way to Go, revient sur cette appropriation des moyens d’expressions cinématographiques pour témoigner des actions militantes. Zineb Sedira a trouvé dans une brocante à Alger des morceaux de pellicule réunis dans une boîte en métal. En les visionnant, elle découvre différentes scènes plus ou moins lisibles selon le degré de dégradation du support celluloïd. Certains visages et actions nous apparaissent clairement, tandis que d’autres semblent se dissoudre en même temps que les émulsions attaquent la pellicule. Zineb Sedira pose alors la question de la survie de ces images et de leur persistance dans le temps. Elle indique ainsi la nécessité d’une conservation préventive pour éviter qu’une part de l’histoire ne s’évanouisse avec elles, renvoyant également à l’importance des cinémathèques dans cette fonction. La numérisation laisse apparaître de chaque côté de l’image les perforations des bobines 16mm et 35mm, de même que la colorisation intégrale de la pellicule noir et blanc en une teinte unique, racontant une histoire des techniques filmiques utilisées. La pellicule rayée peut aussi évoquer la pratique de certains cinéastes expérimentaux des années 1960, notamment Stan Brakhage, qui en grattant les photogrammes de ses films, faisait émerger la matérialité des images cinématographiques.
[C.T.]

Pour cette œuvre récente, produite spécialement pour l’exposition, Zineb Sedira se réfère au dispositif du diorama. Né au début du XIXe siècle et mis en œuvre par Daguerre, un des inventeurs de la photographie, il est, du fait de ses effets illusionnistes et de ses jeux de lumière, un des modèles du cinéma. Associant images et objets réels, il est aussi une forme très utilisée dans les muséums d’histoire naturelle. Il crée un environnement, une mise en situation qui a une valeur tout à la fois pédagogique et spectaculaire. Zineb Sedira met ainsi en avant cet héritage dans sa pratique en reconstituant son salon londonien. [...]
Pour cette œuvre récente, produite spécialement pour l’exposition, Zineb Sedira se réfère au dispositif du diorama. Né au début du XIXe siècle et mis en œuvre par Daguerre, un des inventeurs de la photographie, il est, du fait de ses effets illusionnistes et de ses jeux de lumière, un des modèles du cinéma. Associant images et objets réels, il est aussi une forme très utilisée dans les muséums d’histoire naturelle. Il crée un environnement, une mise en situation qui a une valeur tout à la fois pédagogique et spectaculaire. Zineb Sedira met ainsi en avant cet héritage dans sa pratique en reconstituant son salon londonien. […]

[…] Aux photographies de ses murs s’ajoutent quelques pièces de son mobilier et des objets de sa collection. Entre objets usuels et témoignages culturels, ces artefacts sont présentés comme des traces d’une histoire autant personnelle que collective. Jouant sur l’effet de trompe-l’œil entre les images et la réalité, Zineb Sedira semble nous inciter à reconsidérer les photographies et les objets comme porteurs de récits. Par cette reconstitution, elle s’approprie la démarche historique et muséale. Elle offre en outre une expérience sensorielle aux visiteurs de l’exposition : vivre, regarder, toucher et écouter les années 1960, une décennie décisive pour Zineb Sedira, et ressentir leurs effets persistants dans le temps présent.
[E.L.]
[…] Aux photographies de ses murs s’ajoutent quelques pièces de son mobilier et des objets de sa collection. Entre objets usuels et témoignages culturels, ces artefacts sont présentés comme des traces d’une histoire autant personnelle que collective. Jouant sur l’effet de trompe-l’œil entre les images et la réalité, Zineb Sedira semble nous inciter à reconsidérer les photographies et les objets comme porteurs de récits. Par cette reconstitution, elle s’approprie la démarche historique et muséale. Elle offre en outre une expérience sensorielle aux visiteurs de l’exposition : vivre, regarder, toucher et écouter les années 1960, une décennie décisive pour Zineb Sedira, et ressentir leurs effets persistants dans le temps présent.
[E.L.]
1 À ce sujet : Giorgio Agamben, Création et anarchie : L’œuvre à l’âge de la religion capitaliste, trad. Joël Gayraud, Paris, Éditions Payot et Rivages, 2019