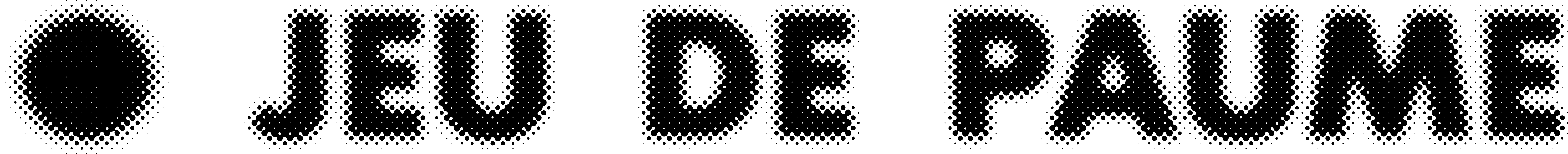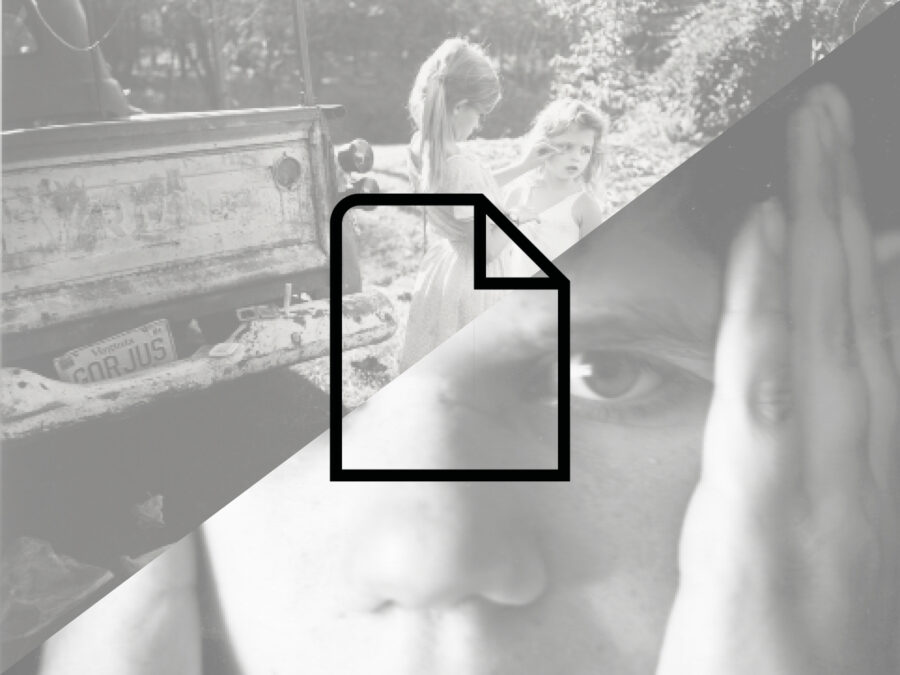Archive magazine (2009 – 2021)
Les invisibles de Sally Mann
Par Étienne Helmer
Du lieu de la bataille la plus meurtrière de la Guerre de Sécession (Antietam, Virginie, 17 sept. 1862), Sally Mann rapporte, un siècle et demi plus tard, une image produite à l’aide des techniques du milieu du XIXe siècle, avec toutes les imperfections des négatifs au collodion : tâches, marbrures et brûlures.
Mais pourquoi le choix de ce procédé littéralement troublant, qui ronge l’image au point de la rendre difficile à voir, même invisible par endroits, alors que des photographies bien plus nettes étaient réalisables à l’époque ? Pourquoi ce fantôme d’image, qui donne quelque chose à voir et simultanément le refuse ?
C’est que tout, ici, est affaire d’invisibilité, sous diverses modalités. À commencer par celle, factuelle, des morts par milliers, absents de l’image et pourtant présents par cette absence même, du moins pour qui sait interpréter la légende. Invisibilité des morts certes, mais aussi de la mort elle-même : elle habite de toutes parts le paysage, elle est ce paysage, mais n’en reste pas moins dérobée au regard, en vertu de l’invisibilité cette fois métaphysique qu’évoque La Rochefoucauld dans sa maxime 26 : « Le soleil ni la mort ne se peuvent regarder fixement. »
La mort impose un regard flottant, de côté, un régime de visibilité forcément trouble et incertain, obligeant la vision à suppléer la vue. Vision que la photographe construit en mêlant aux éléments empiriques fournis par le lieu un imaginaire visuel de l’au-delà, avec cette tâche centrale évoquant un soleil noir qui ne diffuse plus la lumière mais l’absorbe. La mort, monde inversé dont on ne peut rapporter que des images littéralement dé-monstratives, qui soustraient le visible au regard au lieu de le lui exposer.
Cette photographie engage aussi une troisième forme d’invisibilité, liée au statut de l’image qui, d’ordinaire support de mémoire, fait ici le jeu de l’oubli. Sally Mann n’opte ni pour une reconstitution ni pour un travail de style documentaire qui arracherait l’histoire à l’indifférence de ses légataires, mais pour ce qui ressemble à une sorte d’appel visuel que le passé, au bord de la disparition, lancerait au présent, comme s’il l’implorait de ne pas le laisser sombrer dans l’oubli.
Cette dimension rhétorique n’est pas qu’un effet de style lié aux choix esthétiques de la photographe. Car avec cette image en train de se consumer et son contenu menacé d’effacement, Sally Mann rappelle ce qu’il en est de la précarité des photographies comme vecteur de mémoire, dès l’instant que notre regard, sous l’effet du temps et de l’ignorance, ne perçoit qu’un champ dans le champ de bataille d’Antietam. Ce regard produit alors de l’oubli, auquel la photographie n’offre aucun remède, à moins qu’elle n’en fasse paradoxalement son objet propre, comme ici, en obligeant le regard à composer avec l’invisible, à voir tant bien que mal par lui tout en sachant qu’il ne verra pas grand chose.
Étienne Helmer
Étienne Helmer enseigne la philosophie à l’Université de Porto Rico (États-Unis). Ses travaux portent principalement sur la pensée économique, politique et sociale des mondes grecs, ainsi que sur la philosophie de la photographie. Il est l’auteur de La Part du bronze. Platon et l’économie (Vrin, 2010), Épicure ou l’économie du bonheur (Le Passager clandestin, 2013), Le Dernier des Hommes. Figures du mendiant en Grèce ancienne (Le Félin, 2015), Diogène le cynique (Les Belles Lettres, 2017) et Parler la photographie (Mix, 2017).